Tu passes le bac de français ? CLIQUE ICI et deviens membre de commentairecompose.fr ! Tu accèderas gratuitement à tout le contenu du site et à mes meilleures astuces en vidéo.
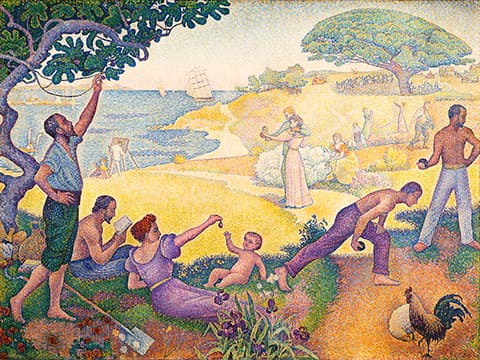
Voici une lecture linéaire d’un extrait de Discours de la servitude volontaire de La Boétie. L’auteur y expose les raisons pour lesquelles la liberté est naturelle à l’homme.
L’extrait étudié va de « Pour l’heure, je ne pense point me tromper en affirmant… » à « mais aussi avec l’objectif de la défendre.
«
Discours de la servitude volontaire, la liberté est naturelle, introduction
Dans ce passage du Discours de la servitude volontaire, Étienne de La Boétie (1530-1563) fait appel à la raison de son lecteur pour lui démontrer, par une argumentation construite, que l’état de servitude est contre-nature, tandis que la liberté est au contraire naturelle, relève de la volonté divine, et doit par conséquent être défendue.
(Voir la fiche de lecture complète sur Discours de la servitude volontaire)
Problématique
Par quelles étapes et quels arguments La Boétie amène-t-il son lecteur à considérer que la liberté est naturelle ?
Extrait étudié
(La translation moderne utilisée est celle du Bibliolycée)
Pour l’heure, je ne pense point me tromper en affirmant qu’il y a en notre âme quelque naturelle* semence de raison, qui, entretenue par les bons conseils et l’habitude, fleurit et devient la vertu*, et qui, au contraire, ne pouvant souvent durer contre les vices qui surviennent, étouffée, avorte[1]. Mais, certes, s’il y a quelque chose de clair et d’évident en la nature, et face à quoi il ne soit pas permis de faire l’aveugle[2], c’est que la nature, le ministre de Dieu, la gouvernante des hommes, nous a tous faits de même forme, et, comme il me semble, au même moule, pour nous permettre de nous reconnaître tous, mutuellement, comme compagnons, ou plutôt comme frères. Et si, dans le partage qu’elle nous a fait de ses dons, elle a offert quelque avantage de corps ou d’esprit aux uns plus qu’aux autres, elle n’a jamais pourtant voulu nous mettre en ce monde comme en un champ clos, et n’a pas envoyé ici-bas les plus forts et les plus avisés, comme des brigands armés dans une forêt, pour y maltraiter les plus faibles. Au contraire, il faut croire plutôt que, faisant ainsi les parts aux uns plus grandes, aux autres plus petites, elle voulait faire naître en eux l’affection fraternelle et leur permettre de la pratiquer, les uns ayant la capacité d’apporter leur aide, et les autres le besoin d’en recevoir. Ainsi donc, puisque cette bonne mère nous a donné à tous toute la Terre pour demeure, nous a tous logés, en quelque sorte, dans la même maison, et nous a tous figurés sur le même moule, afin que, comme en un miroir, chacun pût quasiment reconnaître l’un dans l’autre, si elle nous a fait, à tous, ce beau présent de la voix et de la parole pour nous accorder et fraterniser davantage, et faire, par la commune et mutuelle déclaration de nos pensées, une communion de nos volontés ; si elle a tâché, par tous les moyens, de nouer et de serrer si fortement le nœud de notre alliance et de notre société ; si, enfin, elle a montré, en toutes choses, qu’elle ne voulait pas tant nous faire tous unis, que tous uns[3], dès lors, il ne faut pas douter que nous soyons naturellement* libres*, puisque nous sommes tous compagnons, et il ne peut venir à l’esprit de personne que, nous ayant mis tous en même compagnie, la nature* ait placé certains en servitude[4].
Mais, en vérité, il ne sert absolument à rien de débattre pour savoir si la liberté* est naturelle*, puisqu’on ne peut tenir personne en servitude* sans lui faire de tort[5] et que rien au monde n’est plus contraire à la nature, entièrement raisonnable, que l’injustice. On peut donc en conclure que la liberté* est naturelle, et même, à mon avis, selon le même raisonnement, que nous ne sommes pas nés seulement avec notre liberté*, mais aussi avec l’objectif de la défendre.
[1] avorte : meurt, échoue.
[2] faire l’aveugle : ici, nier l’évidence.
[3] Selon La Boétie, par nature*, tous les hommes non seulement sont destinés à vivre dans l’union (« tous unis »), mais encore appartiennent à la même unité (« tous uns »), celle du genre humain – fraternité et identité doublement innées, synonymes donc de « liberté* naturelle* », qui rendent d’autant plus absurde toute forme de servitude*, comme le précise la fin de cette phrase.
[4] la nature ait placé certains en servitude : selon La Boétie, la servitude n’est nullement un état naturel, puisque, par nature, les hommes naissent tous égaux.
[5] tort : offense, injustice.
Annonce du plan
Le jeune philosophe commence par établir l’évidence de l’égalité entre les hommes et son caractère naturel. (de « Pour l’heure, je ne pense point… » à « ou plutôt comme frères
»)
Il montre ensuite que de cette égalité naturelle découle inévitablement la fraternité qui doit régner parmi les hommes (de « Et si, dans le partage… » à « …le besoin d’en recevoir
», l. 13).
Enfin, il rejette la notion de servitude, incompatible avec légalité et la fraternité. Il conclut en faveur du caractère naturel de la liberté (de « Ainsi donc, puisque cette bonne mère…
» jusqu’à la fin).
I – L’égalité entre les hommes est évidente et naturelle
(de « Pour l’heure, je ne pense point… » à « ou plutôt comme frères
»)
A – Le jardin de l’âme et la fleur de la raison
Comme le fait le philosophe René Descartes un siècle plus tard, La Boétie affirme en quelque sorte que la « raison » (l. 2) est « la chose du monde la mieux partagée » (René Descartes écrit dans son Discours de la méthode (1637) cette célèbre phrase : « Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée
» )
La Boétie affirme en effet : « il y a en notre âme quelque naturelle semence de raison
« . L’usage du présent de vérité générale (« il y a ») et du possessif « notre » (l. 1) montrent la valeur universelle de cette affirmation.
Il contrevient immédiatement aux objections éventuelles en signalant que cette « semence de raison
» (l. 2), avec une métaphore empruntée au monde végétal, ne se développe pas de la même manière chez tous : « entretenue par les bons conseils et l’habitude, [elle] fleurit et devient la vertu
».
Il file ainsi la métaphore de la raison comme un jardin à cultiver.
Si la raison n’est pas entretenue, « au contraire, ne pouvant souvent durer contre les vices qui surviennent, étouffée, [elle] avorte
» (l. 2-3). Ces vices sont donc comme les mauvaises herbes, les ronces qui viennent étouffer la belle plante de la raison.
La métaphore de l’avortement, quant à elle, est tirée du monde animal.
Mais ce qui importe à La Boétie n’est pas de développer ces différences d’éducation, mais d’établir que chacun possède une raison suffisante en lui-même pour faire preuve de bon sens et se rendre à l’évidence.
B – Une évidence : l’égalité naturelle entre les hommes
Or la première évidence (« quelque chose de clair et d’évident dans la nature
») est la suivante : les hommes sont égaux.
Nier ou ne pas voir cette égalité relève de la mauvaise foi. En effet, il s’agit pour La Boétie d’une évidence « face à quoi il ne soit pas permis de faire l’aveugle
» . L’expression « faire l’aveugle » indique en effet un comportement contrefait et mensonger.
L’égalité entre les hommes procède de la « nature ». Le philosophe personnifie et place la nature jen dessous de « Dieu » mais au-dessus des hommes : « la nature, le ministre de Dieu, la gouvernante des hommes
» (l. 5). C’est à elle, par conséquent, qu’obéit directement l’humanité.
Or cette nature « nous a tous faits de même forme
», écrit La Boétie, qui développe son idée grâce à une métaphore empruntée au vocabulaire du modelage : « au même moule », avec répétition de l’adjectif « même ».
Derrière cette métaphore se trouve le souvenir d’anciens mythes antiques, tels que celui d’Héphaïstos modelant l’homme dans l’argile.
La nature personnifiée a un but en agissant ainsi, comme l’exprime la proposition qui suit : « pour nous permettre de nous reconnaître tous
» . Le verbe « permettre » sous-entend que la nature rend ainsi service aux hommes : cette égalité est un bienfait. Le verbe pronominal « se reconnaître », à la première personne du pluriel, exprime la réciprocité de cette reconnaissance.
Plus loin, l’ajout de l’adverbe « mutuellement » (l. 7) abonde dans le même sens : les hommes se font face comme dans un miroir.
La Boétie qualifie ainsi les hommes de « compagnons« , puis, par un jeu d’épanorthose, il vient affiner sa pensée pour aboutir au lien le plus étroit qui soit : « frères » . (L’épanorthose est une figure de style qui consiste à revenir sur ce que l’on vient d’affirmer pour le nuancer)
II – Les inégalités sont un appel à la fraternité
(de « Et si, dans le partage… » à « …le besoin d’en recevoir
» )
A – La loi du plus fort n’est pas naturelle
Ayant établi l’égalité naturelle entre les hommes, le jeune philosophe fait toutefois une concession qui s’exprime dans la proposition conditionnelle (« Et si »).
On y retrouve la notion ancienne d’un « partage » des « dons » inégal. La Boétie prend l’exemple de la force physique et de la force mentale : « Et si […] elle a offert quelque avantage de corps ou d’esprit aux uns plus qu’aux autres
» .
Mais cette concession n’a pour but que de préparer une explication qui cherche à détromper les hommes et les guider vers une juste interprétation de la « volonté » de la nature, qui est une volonté divine : « elle n’a jamais pourtant voulu
» (l. 8-9).
Dans les lignes qui suivent, le verbe vouloir réapparaît (« elle voulait », l. 12), qui prolonge la personnification de la nature, force supérieure, de même que les verbes d’action dont elle est sujet : « nous mettre en ce monde » (l. 9), « n’a pas envoyé » (l. 9), « faisant ainsi » (l. 11), « faire naître
» (l. 12).
Les hommes sont grammaticalement objets (COD) des actions de la nature qui trace leur destin.
Or La Boétie cherche à détromper ses lecteurs sur les intentions de la nature par deux propositions négatives tout d’abord, qui nient toute intention malveillante de la part de la nature.
Tout d’abord, « elle n’a jamais voulu nous mettre en ce monde comme en un champ clos
» (l. 8-9), c’est-à-dire mettre les hommes en situation de victimes incapables de s’échapper.
Ensuite, elle « n’a pas envoyé ici-bas les plus forts et les plus avisés
» (l. 9-10), qui sont comparés à des « brigands armés dans une forêt, pour y maltraiter les plus faibles
» (l. 10) pour soumettre les autres.
La Boétie prétend donc que la loi du plus fort ne provient pas de la nature qui est bonne en elle-même.
Elle ne provient que d’une mauvaise interprétation de la part des hommes de la volonté divine.
B – Une fraternité toute chrétienne
La Boétie énonce dans une phrase affirmative ce qu’il considère comme la juste interprétation de ces inégalités : « Au contraire, il faut croire plutôt que
» (l. 11).
La métaphore des « parts » que la Destinée attribue à chacun, « aux uns plus grandes, aux autres plus petites
» (l. 11), reformule l’idée de l’inégalité des sorts et des destins, tandis que le participe présent « faisant » (l. 11) réaffirme la responsabilité de cette nature, ministre divin.
Or ces inégalités sont comprises par La Boétie comme une épreuve menant à la fraternité : « elle voulait faire naître en eux l’affection fraternelle et leur permettre de la pratiquer
» .
On retrouve ici le verbe « permettre », qui signale un bienfait rendu par la nature.
Les deux propositions participiales qui suivent tiennent lieu d’explication : « les uns ayant la capacité d’apporter leur aide
» (l. 12-13), dans une logique de charité chrétienne ; « les autres le besoin d’en recevoir
» (l. 13).
Les inégalités sont donc, dans la pensée chrétienne de La Boétie, une opportunité d’exercer sa bonté. La volonté de la nature, qui se confond avec la volonté divine, ne peut être mauvaise.
III – La liberté est naturelle et doit être défendue
(de « Ainsi donc, puisque cette bonne mère…
» jusqu’à la fin).
A – Synthèse des arguments exposés dans la première partie du discours
Dans la deuxième moitié du texte, La Boétie reprend les images et arguments énoncés plus haut pour conduire le lecteur vers ses conclusions.
Après les adverbes conclusifs (« ainsi donc »), c’est une longue énumération de propositions causales (« puisque », l. 13) et conditionnelles (« si », l. 16, 18, 19) qui se déroule.
Ces propositions reformulent les arguments précédents, et, comme dans un raisonnement mathématique, les posent comme conditions des déductions qui sont formulées dans la proposition principale (« dès lors, il ne faut pas douter que…
», l. 20).
La bonté fondamentale de la volonté divine est reprise dans la personnification de la nature en « bonne mère » (l. 13), figure tutélaire bienfaitrice et donatrice (« nous a donné », l. 13-14).
C’est l’idée d’un don égal et d’une égalité de statut qui reprend le dessus : « nous a donné à tous toute la Terre pour demeure
» (« l. 14).
Le pronom personnel « tous », au pluriel, et l’adjectif « toute », placés à la suite, insiste sur cette idée d’égalité. Le pronom « tous » est ensuite répété maintes fois dans cette longue phrase énumérative (« tous logés », l. 14 ; « tous figurés », l. 15 ; « elle nous a fait, à tous », l. 16 ; « tous unis », « tous uns », l. 20 ; « tous compagnons », l. 21 ; « tous en même compagnie
», l. 22), pour marteler l’idée d’égalité.
La répétition de l’adjectif « même » : « la même maison » (l. 14), « sur le même moule » (l. 15), « en même compagnie
» (l. 22) appuie également l’idée d’égalité.
La Boétie complète donc ses arguments en faveur de l’égalité des hommes par l’idée d’un habitat commun pour tous : la Terre, où les hommes sont « tous logés, en quelque sorte, dans la même maison
» .
Cette dernière métaphore fait paraître la Terre non pas comme espace immense et sauvage, mais au contraire comme exiguë et familière, lieu où les hommes se côtoient et sont proches les uns des autres. La bonne entente s’impose donc.
L’auteur reprend ensuite l’idée de la ressemblance physique avec la métaphore du modelage : « nous a tous figurés sur un même moule » (l. 15).
Puis c’est l’image du « miroir » (l. 15-16) qui ajoute l’idée d’une reconnaissance mutuelle déjà exprimée aux lignes 6 et 7 : « afin que, comme en un miroir, chacun pût quasiment reconnaître l’un dans l’autre
».
B – Le rôle de la parole et de la raison dans la formation d’une communauté harmonieuse
Mais un argument nouveau survient : celui de la « voix et de la parole » (l. 16).
C’est un autre don (« ce beau présent », l. 16) de la nature, qui n’a d’autre finalité que la fraternité : « pour nous accorder et fraterniser davantage
» (l. 16-17).
L’adverbe « davantage » indique qu’il y a dans la parole une raison supplémentaire de fraterniser, car elle permet de « s’accorder », de s’expliquer (« par la commune et mutuelle déclaration de nos pensées », l. 17), d’exprimer ses désirs et intentions (« une communion de nos volontés », l. 17-18), et d’éviter les désaccords.
Pour exprimer cet idéal d’harmonie, La Boétie use des champs lexicaux de la « communauté » (« commune », « mutuelle », « communion », puis « société
» ) .
C’est ensuite l’idée de l’union qui s’impose, avec le substantif « alliance » (l. 19), et les expressions « tous unis », « tous uns » (l. 20).
Enfin, c’est l’idée du compagnonnage : « tous compagnons », « tous en même compagnie
» (l. 21-22).
La nature a donc mis l’Homme en situation d’union et de fraternité, « par tous les moyens possible
» , et la métaphore du « nœud » (l. 18) illustre ce destin commun auxquels les hommes ne peuvent échapper.
La Boétie réaffirme qu’il s’agit d’une volonté de la nature, donc divine : « elle a montré, en toutes choses, qu’elle ne voulait pas tant nous faire tous unis, que tous uns
» (l. 19-20).
Quant à cette gradation qui monte de « tous unis » à « tous uns », elle exprime à nouveau l’idée non seulement de l’alliance inévitable entre les hommes, mais aussi de leur unité, de leur identité et de leur égalité au sein du genre humain.
C – Conclusion du raisonnement : la liberté est naturelle et doit être défendue
Quand toutes ces conditions sont posées, La Boétie peut en venir à ses conclusions : « dès lors, il ne faut pas douter que nous soyons tous naturellement libres
» .
La Boétie établit ainsi une relation logique et causale entre l’égalité et l’identité de tous et la liberté : « il ne peut venir à l’esprit de personne que, nous ayant mis tous en même compagnie, la nature ait placé certains en servitude
» .
On retrouve ici l’appel au simple bon sens déjà formulé au tout début du passage. Quant à la servitude, elle apparaît comme incompatible avec la volonté de la nature. La chose est tellement évidente que La Boétie écarte tout débat : « Mais, en vérité, il ne sert absolument à rien de débattre pour savoir si la liberté est naturelle
» .
Il s’en explique juste après avec deux propositions causales (« puisqu’on ne peut… injustice
» ), qui poursuivent le même raisonnement rigoureux.
La Boétie reprend la notion de « servitude » et l’associe à celle de « tort ». Or faire du tort à quelqu’un relève de l’« injustice », puisque c’est nier qu’il est égal à soi et le traiter en inférieur.
De là, La Boétie prouve à nouveau que la servitude est « contraire à la nature » .
L’auteur termine son « raisonnement » (l. 26) en énonçant une conclusion claire et nette : « On peut donc en conclure que la liberté est naturelle
» (l. 26).
Le passage se clôt sur l’ouverture vers une nouvelle question : « nous ne sommes pas nés seulement avec notre liberté, mais aussi avec l’objectif de la défendre
» (l. 26-27). Cette simple phrase oriente le discours vers la politique et interroge implicitement le lecteur sur l’état de sa propre liberté.
Conclusion
Étienne de La Boétie montre ici par un raisonnement clair, argumenté et mathématique que la liberté est naturelle.
Cette argumentation repose sur quelques notions capitales : La nature a fait les hommes égaux. Cette égalité ne peut être niée : elle est évidente, se montre partout en toutes choses, et ne peut être qu’issue de la volonté de la nature.
Or de cette égalité fondamentale découlent forcément la fraternité, la liberté et le rejet de la servitude, logiquement et rationnellement incompatible avec l’égalité.
Deux cents ans avant les Philosophes des Lumières et la Révolution française, La Boétie raisonne donc sur trois notions qui s’ancreront profondément dans la pensée française moderne : égalité, liberté, fraternité.
Tu étudies Discours de la servitude volontaire ? Regarde aussi :
- Discours de la servitude volontaire : dissertation corrigée
- Discours de la servitude volontaire, exposé du sujet (début)
- Discours de la servitude volontaire, la description de la servitude du peuple (« peuples misérables… »)
- Discours de la servitude volontaire, comment la servitude s’installe par habitude
- Discours de la servitude volontaire, les ruses pour abêtir le peuple
- Discours de la servitude volontaire, le système pyramidal du pouvoir (analyse linéaire)
Les 3 vidéos préférées des élèves :
- La technique INCONTOURNABLE pour faire décoller tes notes en commentaire [vidéo]
- Quel sujet choisir au bac de français ? [vidéo]
- Comment trouver un plan de dissertation ? [vidéo]
Tu entres en Première ?
Commande ton livre 2026 en cliquant ici ⇓

En Troisième ?
Ton livre pour le Brevet ici ⇓

