Tu passes le bac de français ? CLIQUE ICI et deviens membre de commentairecompose.fr ! Tu accèderas gratuitement à tout le contenu du site et à mes meilleures astuces en vidéo.
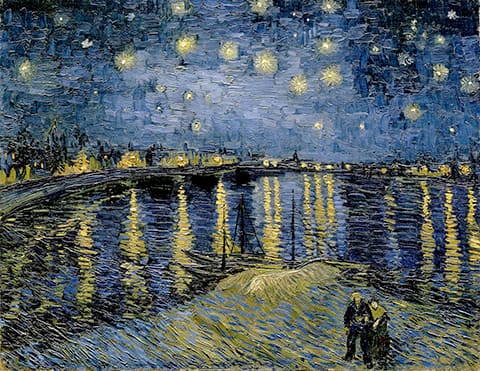
Voici une analyse linéaire pour le bac de français du « Premier Soir » issu des Entretiens sur la pluralité des mondes de Fontenelle.
L’extrait analysé va de « Sur cela je me figure toujours que la nature » à « ne roule que sur des choses si simples
». Il s’agit de la comparaison entre la nature et un spectacle de l’Opéra.
Introduction
En 1686, Fontenelle publie ses Entretiens sur la pluralité des mondes. Onze ans plus tard, il sera nommé à l’Académie des Sciences et ne cessera d’actualiser son ouvrage à partir des découvertes scientifiques.
Au nombre de 7, ces entretiens se présentent comme des conversations à la fois plaisantes et scientifiques entre un philosophe plutôt cartésien et une Marquise, à l’intelligence vive. (Voir la fiche de lecture des Entretiens sur la pluralité des mondes)
Lors de promenades nocturnes dans un château normand, tous deux s’interrogent sur l’univers, l’astronomie, les phénomènes naturels.
Extrait étudié
Sur cela je me figure toujours que la nature est un grand spectacle qui ressemble à celui de l’opéra. Du lieu où vous êtes à l’opéra, vous ne voyez pas le théâtre tout-à-fait comme il est ; on a disposé les décorations et les machines, pour faire de loin un effet agréable, et on cache à votre vue ces roues et ces contrepoids qui font tous les mouvements. Aussi ne vous embarrassez vous guère de deviner comment tout cela joue. Il n’y a peut-être guère de machiniste caché dans le parterre, qui s’inquiète d’un vol qui lui aura paru extraordinaire et qui veut absolument démêler comment ce vol a été exécuté. Vous voyez bien que ce machiniste-là est assez fait comme les philosophes. Mais ce qui, à l’égard des philosophes, augmente la difficulté, c’est que dans les machines que la nature présente à nos yeux, les cordes sont parfaitement bien cachées, et elles le sont si bien qu’on a été long-temps à deviner ce qui causait les mouvements de l’univers. Car représentez-vous tous les sages à l’opéra, ces Pythagore, ces Platon, ces Aristote, et tous ces gens dont le nom fait aujourd’hui tant de bruit à nos oreilles ; supposons qu’ils voyaient le vol de Phaéton que les vents enlèvent, qu’ils ne pouvaient découvrir les cordes, et qu’ils ne savaient point comment le derrière du théâtre était disposé. L’un d’eux disait : C’est une certaine vertu secrète qui enlève Phaéton. L’autre, Phaéton est composé de certains nombres qui le font monter. L’autre, Phaéton a une certaine amitié pour le haut du théâtre ; il n’est point à son aise quand il n’y est pas. L’autre, Phaéton n’est pas fait pour voler, mais il aime mieux voler, que de laisser le haut du théâtre vide ; et cent autres rêveries que je m’étonne qui n’oient perdu de réputation toute l’Antiquité. À la fin Descartes, et quelques autres modernes sont venus, qui ont dit : Phaéton monte, parce qu’il est tiré par des cordes, et qu’un poids plus pesant que lui descend. Ainsi on ne croit plus qu’un corps se remue, s’il n’est tiré, ou plutôt poussé par un autre corps ; on ne croit plus qu’il monte ou qu’il descende, si ce n’est par l’effet d’un contrepoids ou d’un ressort ; et qui verrait la nature telle qu’elle est, ne verrait que le derrière du théâtre de l’opéra. À ce compte, dit la Marquise, la philosophie est devenue bien mécanique ? Si mécanique, répondis-je, que je crains qu’on en ait bientôt honte. On veut que l’univers ne soit en grand, que ce qu’une montre est en petit, et que tout s’y conduise par des mouvements réglés qui dépendent de l’arrangement des parties. Avouez la vérité. N’avez-vous pas eu quelquefois une idée plus sublime de l’univers, et ne lui avez-vous point fait plus d’honneur qu’il ne méritait ? J’ai vu des gens qui l’en estimaient moins, depuis qu’ils l’avoient connu. Et moi, répliqua-t-elle, je l’en estime beaucoup plus, depuis que je sais qu’il ressemble à une montre. Il est surprenant que l’ordre de la nature, tout admirable qu’il est, ne roule que sur des choses si simples.
Problématique
Comment Fontenelle oppose-t-il dans cet extrait deux conceptions philosophiques de l’univers ?
Plan linéaire
Dans un premier temps, nous analyserons la métaphore filée de la nature comme spectacle d’opéra, puis nous mettrons en évidence la critique des philosophes antiques.
Dans un dernier temps, nous verrons que l’auteur propose une défense nuancée d’une lecture cartésienne de l’univers.
I – La nature comme spectacle d’Opéra
De « Sur cela, je me figure toujours que la nature est un grand spectacle » à « ce machiniste-là est assez fait comme les philosophes.
«
L’auteur commence par faire de la nature un spectacle.
L’emploi de « je me figure
» montre que cette vision est subjective et découle d’une construction mentale personnelle.
La métaphore « la nature est un grand spectacle
» suggère une représentation totale propre à captiver des observateurs, et par là-même une mise en scène réfléchie.
Ainsi, pour l’auteur, à l’instar de l’opéra, la nature a donc une dimension esthétique et orchestrée.
La comparaison « qui ressemble à celui de l’Opéra
» n’est pas anodine : il s’agit d’un art où la richesse et la profusion des détails, la beauté des costumes, la beauté des voix sont uniques, procurant ainsi des émotions fortes.
Le lecteur comprend que notre perception de la nature – ou du monde- est, en quelque sorte, limitée par notre position d’observateur, comme le souligne le recours à la négation « vous ne voyez pas
».
Le pronom personnel « vous » s’adresse à la fois à la Marquise, à Monsieur L, et de façon plus vaste, au lecteur.
Ici, l’opéra devient une métaphore de notre incapacité à saisir la totalité de la réalité.
Le recours au pronom « on », volontairement impersonnel, désigne une puissance qui n’est pas nommée mais qui a un pouvoir sur la nature, comme l’illustrent les verbes d’action « on a disposé » et « on cache à votre vue
».
Ainsi, le lecteur comprend qu’une force supérieure est capable d’organiser la structure et la beauté de la nature – les compléments d’objet direct « les décorations et les machines
» en sont la preuve – dans un but, comme le souligne le complément circonstanciel de but « pour faire de loin un effet agréable
».
Mais la conjonction de coordination « et » à valeur adversative souligne également qu’au-delà d’une perception plaisante de la nature, le spectateur peut ne pas percevoir les mécanismes qui la sous-tendent, rendus par la métaphore de termes techniques « ces roues et ces contrepoids
».
Cela évoque l’idée que, comme au théâtre, d’une part, l’apparence extérieure de la nature est conçue pour plaire et est présentée comme harmonieuse et ordonnée ; d’autre part, que cette harmonie repose sur des mécanismes invisibles, complexes et peut-être désordonnés.
Par la suite, l’auteur établit un lien de cause à effet par l’adverbe « aussi » et s’adresse à nouveau directement au spectateur et au lecteur en général. L’impératif présent « ne vous embarrassez-vous guère
» montre une forme de désintérêt vis-à-vis des rouages internes du monde et renforce l’idée que la plupart des gens se contentent de la beauté apparente, sans chercher à en comprendre les mécanismes.
La métaphore théâtrale, et plus précisément de l’opéra, se poursuit par l’introduction du « machiniste caché dans le parterre
». Ce nouveau participant pourrait symboliser le philosophe ou l’homme de science, c’est-à-dire une personne qui, contrairement aux autres, cherche à comprendre les mécanismes cachés derrière les apparences.
Le lecteur peut voir dans l’utilisation du terme « vol » les effets spectaculaires parfois produits par les machines de scène. Ces effets spectaculaires représentent les mystères scientifiques qui fascinent le philosophe « qui veut absolument démêler comment ce vol a été exécuté
» .
Fontenelle invite ainsi le lecteur à ne pas se satisfaire des apparences mais à découvrir ce qui se cache derrière le spectacle du monde. Il souligne que la pensée rationnelle ou philosophique constitue un effort qui permet de décoder la complexité des lois naturelles.
L’auteur rapproche ensuite explicitement les deux figures – celles du machiniste et du philosophe (qui représente à cette époque le scientifique) : « Vous voyez bien que ce machiniste-là est assez fait comme les philosophes.
»
En effet, tous deux s’interrogent sur les processus cachés derrière le spectacle apparent. Ils ne se satisfont pas de la beauté de la surface, mais veulent en comprendre le fonctionnement. Ils sont donc tous deux dans une position active et curieuse pour comprendre le spectacle de la nature.
II – La critique des philosophes de l’Antiquité
De « Mais ce qui, à l’égard des philosophes » à « qui n’aient perdu de réputation toute l’Antiquité
«
Fontenelle passe à un niveau de complexité supérieure, comme l’indique la mise en relief avec la formule emphatique « ce qui […] augmente la difficulté, c’est que
».
Il souligne qu’il est difficile de comprendre les causes véritables des phénomènes naturels. Si l’on constate que la métaphore de la nature comme machine est à nouveau employée, celle des « cordes » cachées est nouvelle mais rappelle les roues et contrepoids vus dans le premier mouvement.
Les philosophes se heurtent donc à des forces ou des causes invisibles qui produisent les mouvements de l’univers. Le recours à l’adverbe « longtemps » renforce l’idée que cette quête de vérité a été lente et laborieuse. Fontenelle souligne donc qu’il y a une opposition entre les apparences, c’est-à-dire ce qui est visible, et la réalité, à savoir les causes cachées.
Afin de rendre son propos plaisant, l’auteur continue à impliquer son lecteur dans sa réflexion, par le biais de l’impératif « représentez-vous ». Il lui propose donc d’imaginer sa propre pièce de théâtre.
Alors qu’il avait jusqu’ici invité la marquise et le lecteur à s’imaginer spectateurs de l’Opéra, il les pousse désormais à imaginer que ce sont les grands philosophes de l’Antiquité qui sont ces spectateurs, avec une énumération qui va crescendo : «tous les sages à l’opéra, ces Pythagore, ces Platon, ces Aristote, et tous ces gens dont le nom fait aujourd’hui tant de bruit à nos oreilles »
.
Les propositions subordonnées conjonctives complétives en rythme ternaire « supposons qu’ils voyaient […], qu’ils ne pouvaient […] et « qu’ils ne savaient point »
sont particulièrement plaisantes et renforcent l’ampleur de l‘impuissance des philosophes de l’Antiquité face au mystère du « vol » spectaculaire sur scène.
Le spectacle repose sur une référence mythologique : le vol de Phaéton enlevé par les vents. ce vol spectaculaire qui a lieu sur scène symbolise les phénomènes naturels comme les mouvements des planètes, les forces naturelles que les philosophes antiques cherchent désespérément à comprendre, en vain.
En effet, leurs efforts sont accompagnés de la négation : ne pas pouvoir « découvrir les cordes », ne pas savoir « comment le derrière du théâtre était disposé.
» Ainsi, l’auteur met en exergue les limites de la philosophie antique pour saisir des vérités scientifiques.
Ensuite, l’auteur fait prendre la parole aux philosophes, au style direct (« l’un deux disait ») pour mieux tourner en ridicule leurs positions contradictoires : il avance, pour chacun d’eux, une hypothèse farfelue pour expliquer le vol de Phaéton : « une certaine vertu secrète
», les « nombres » qui font monter, ou bien encore « une certaine amitié pour le haut du théâtre
». Par cet usage manifeste de l’ironie, le lecteur comprend que ces réponses sont inadaptées et absurdes pour expliquer le phénomène du vol.
D’ailleurs, le groupe nominal « cent autres rêveries
» confirme la position de Fontenelle qui se moque des explications mystiques ou numérologiques des philosophes de l’Antiquité face aux mystères du monde. Cette phrase marque la condamnation sévère des systèmes philosophiques antiques, incapables de saisir les causes rationnelles des phénomènes visibles.
III – Une lecture cartésienne de l’univers à nuancer
De « À la fin, Descartes et quelques autres modernes » à « ne roule que sur des choses si simples.
«
Ce dernier mouvement introduit un net changement chronologique et philosophique : « À la fin Descartes, et quelques autres modernes sont venus
».
Comme précédemment, l’auteur leur fait prendre la parole directement. Ainsi, contrairement aux anciens philosophes, l’avènement de Descartes et des philosophes modernes explique le phénomène du vol de Phaéton par des principes mécaniques : les propositions subordonnées circonstancielles de cause « parce qu’il est tiré par des cordes, et qu’un poids plus pesant que lui descend
. » le confirment.
Le lecteur comprend que l’univers peut s’expliquer par des causes matérielles et mesurables, comme le soulignent le champ lexical de la mécanique : « monte », « tiré », « pesant », « descend », « poussé », « corps », « l’effet d’un contrepoids ou d’un ressort. »
Ainsi, la répétition de l’expression « on ne croit plus » met en lumière la rupture avec les anciennes croyances et consacre l’explication rationnelle : le mouvement naît d’une action (comme l’indiquent les participes passés « tiré » et « poussé ») réalisée « par un autre corps » ou d’un « effet d’un contrepoids ». Ici, Fontenelle expose un principe fondamental de la physique mécanique : un corps ne peut se mouvoir que grâce à une force extérieure.
Cette conception contraste fortement avec les idées métaphysiques des philosophes antiques. Le lecteur voit ici l’émergence des lois de la physique moderne, où tout mouvement est causé par un déplacement d’un corps sous l’effet d’une force.
Fontenelle utilise à nouveau la métaphore artistique dans une phrase qui sonne comme une maxime : « qui verrait la nature telle qu’elle est, ne verrait que le derrière du théâtre de l’opéra
». L’usage du conditionnel présent fait partie de la critique implicite de l’auteur : à ce stade, on comprend que ce qui est visible est soumis à des lois mécaniques qui permettent le mouvement des corps.
Mais l’auteur suggère également une vision désenchantée de la nature. Cette dernière n’est plus perçue comme un espace mystérieux rempli de forces invisibles et magiques, mais comme une machine complexe régie par des lois physiques immuables et prévisibles.
D’ailleurs, la Marquise elle-même exprime, au discours direct, sa surprise : « la philosophie est devenue bien mécanique ?
» L’auteur joue ici sur le double sens de l’adjectif « mécanique », qui fait référence à l’approche matérialiste et mécanique de la nature par Descartes mais qui signifie aussi, à cette époque, « mesquin« . L’interrogation sous-entend donc une certaine critique face à cette perception désenchantée du monde.
La réponse de l’auteur peut surprendre car il ne nie pas ce désenchantement, et instaure au contraire un lien de cause à conséquence entre celui-ci et les découvertes scientifiques modernes : « Si mécanique […] que je crains qu’on en ait bientôt honte.
» Il admet donc craindre une sorte de déshumanisation ou de désenchantement, où la poésie et la profondeur des phénomènes naturels seraient réduites à des mécanismes simples.
Une seconde métaphore est utilisée de façon antithétique : « On veut que l’univers ne soit en grand, que ce qu’une montre est en petit ». Selon la vision mécaniste, l’univers n’est qu’une machine ordonnée et réglée, comme une montre. Cette analogie souligne le caractère prévisible, ordonné et matériel de l’univers, selon les philosophes modernes.
Par l’utilisation du présent d’habitude et la proposition subordonnée relative « qui dépendent de l’arrangement des parties. », Fontenelle souligne à quel point la pensée mécaniste est réductrice.
Il va s’attacher à le montrer, tout en donnant à son propos un tour plaisant, que laisse transparaître le recours à la deuxième personne du pluriel- qui désigne à la fois la Marquise et le lecteur universel : « Avouez la vérité », « n’avez-vous pas eu
».
Le philosophe souligne le contraste entre une explication rationnelle et « une idée plus sublime de l’univers
». Ce comparatif rappelle les anciennes conceptions de l’univers qui laissaient au mystère et à la grandeur toute leur place. Par son constat désabusé « J’ai vu des gens qui l’en estimaient moins, depuis qu’ils l’avaient connu.
», Fontenelle admet que la connaissance de l’univers peut conduire à la perte du respect.
Mais, dans cet extrait, la Marquise a le dernier mot (« Et moi, répliqua-t-elle
») et marque une opposition : « je l’en estime beaucoup plus, depuis que je sais qu’il ressemble à une montre
».
Elle confie et justifie son étonnement ainsi : « Il est surprenant que l’ordre de la nature, tout admirable qu’il est, ne roule que sur des choses si simples.
» Ainsi, Fontenelle montre que la simplicité apparente des lois de la nature n’enlève rien à la beauté de l’univers, au contraire. L’ordre naturel, aussi mécanique soit-il, est perçu comme une forme de perfection, une organisation intelligente et admirable qui suscite l’émerveillement.
« Premier Soir », Conclusion
Cet extrait issu du « Premier soir » des Entretiens de Fontenelle aborde le débat entre deux conceptions de l’univers : d’une part, celle incarnée par les philosophes antiques, critiquable par sa vision mystique, mais louable par sa lecture poétique du monde ; d’autre part, celle portée par les philosophes modernes et Descartes, qui proposent des explications rationnelles mais réduisent aussi l’univers à une vision mécaniste.
Le dialogue entre le philosophe et la Marquise explore ainsi la tension entre une compréhension rationnelle et mécanique du monde, et une approche plus intuitive et métaphysique. La conclusion de ce texte rappelle aussi que la grandeur de l’univers peut résider dans sa simplicité apparente.
Tu étudies Entretiens sur la pluralité des mondes ? Regarde aussi :
Les 3 vidéos préférées des élèves :
- La technique INCONTOURNABLE pour faire décoller tes notes en commentaire [vidéo]
- Quel sujet choisir au bac de français ? [vidéo]
- Comment trouver un plan de dissertation ? [vidéo]
Tu entres en Première ?
Commande ton livre 2026 en cliquant ici ⇓

En Troisième ?
Ton livre pour le Brevet ici ⇓

