Tu passes le bac de français ? CLIQUE ICI et deviens membre de commentairecompose.fr ! Tu accèderas gratuitement à tout le contenu du site et à mes meilleures astuces en vidéo.
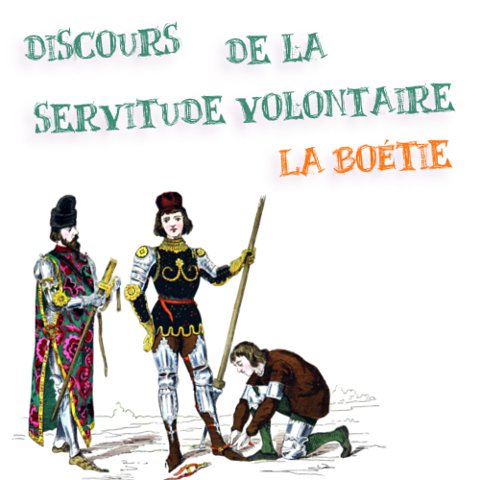 Voici une analyse linéaire (pour l’oral) suivie d’un commentaire composé (pour l’écrit) d’un extrait clé de Discours de la servitude volontaire de La Boétie.
Voici une analyse linéaire (pour l’oral) suivie d’un commentaire composé (pour l’écrit) d’un extrait clé de Discours de la servitude volontaire de La Boétie.
L’extrait étudié va de « Pauvres et misérables peuples insensés » à « s’effondrer de son propre poids et se briser.«
Discours de la servitude volontaire : analyse linéaire
Description de la servitude du peuple, introduction
Dans son célèbre Discours de la servitude volontaire, Étienne de La Boétie (1530-1563), étudiant en droit, jeune humaniste français, s’étonne de voir de nombreux peuples asservis au profit d’un monarque tyrannique. (Voir la fiche de lecture complète de Discours de la servitude volontaire)
Comment la multitude peut-elle être asservie par un seul ?
Dans ce passage passionné, La Boétie tente, de manière énergique, de tirer les peuples de cette absurdité, et de les sortir de leur aveuglement pour les guider vers la liberté.
Problématique
Quel argumentaire le jeune humaniste déploie-t-il pour susciter la réaction de ses lecteurs et mettre en évidence le paradoxe de la servitude volontaire ?
Extrait étudié
La translation moderne utilisée ici est celle du Bibliolycée
Pauvres et misérables peuples* insensés, nations opiniâtres en votre mal[1] et aveugles en votre bien[2], vous vous laissez confisquer, sous vos propres yeux, le plus beau et le plus clair de votre revenu[3], piller vos champs, voler vos maisons et les dépouiller des meubles anciens et paternels ! Vous vivez de telle sorte que vous ne pouvez vous vanter de posséder quoi que ce soit, et il semblerait que vous verriez maintenant comme un grand bonheur de n’être que les locataires de vos biens, de vos familles, de vos vies. Et tout ce dégât, ce malheur, cette ruine enfin vous viennent, non pas des ennemis, mais bien, certes, oui, de l’ennemi, et de celui-là même que vous faites si grand qu’il est, pour qui vous allez si courageusement à la guerre, pour la grandeur duquel vous ne refusez point de présenter à la mort vos personnes. Celui qui vous maîtrise tant n’a pourtant que deux yeux, n’a que deux mains, n’a qu’un corps, et n’a rien de plus que n’ait le moindre habitant du nombre infiniment grand de nos villes, sinon l’avantage que vous lui fournissez pour vous détruire. D’où a-t-il pris tant d’yeux dont il vous épie, si ce n’est pas vous qui les lui donnez ? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper, s’il ne les prend de vous ? Les pieds dont il foule vos cités, d’où les a-t-il, s’ils ne sont les vôtres ? Comment a-t-il le moindre pouvoir sur vous, autrement que par vous-mêmes ? Comment oserait-il vous poursuivre, s’il n’était d’intelligence avec vous[4] ? Quel mal pourrait-il vous faire, si vous n’étiez receleurs[5] du larron[6] qui vous pille, complices du meurtrier qui vous tue, et traîtres à vous-mêmes ? Vous semez vos fruits, pour qu’il les dévaste ; vous meublez et remplissez vos maisons, pour fournir à ses pillages ; vous nourrissez vos filles, afin qu’il puisse assouvir sa luxure[7] ; vous nourrissez vos enfants, afin que – pour le mieux qu’il leur saurait faire ! – il les mène en ses guerres, qu’il les conduise à la boucherie[8], qu’il en fasse les ministres de ses convoitises[9], et les exécuteurs de ses vengeances. Vous tuez à la tâche vos propres personnes, afin qu’il puisse jouir délicieusement et se vautrer dans ses sales et vilains plaisirs. Vous vous affaiblissez, afin de le rendre plus fort et plus rude à vous tenir la bride plus courte[10]. Et de tant d’indignités, que les bêtes elles-mêmes ou ne sentiraient point ou n’endureraient point[11], vous pouvez vous délivrer, si vous essayez, non pas de vous en délivrer, mais seulement de vouloir le faire. Soyez donc résolus à[12] ne plus rester en servitude*, et vous voilà libres*. Je ne veux pas que vous le poussiez, ni que vous l’ébranliez[13], mais seulement ne le soutenez plus, et vous le verrez, comme un grand colosse dont on a dérobé[14] la base, s’effondrer de son propre poids et se briser.
[1] opiniâtres en votre mal : acharnées à faire votre malheur (en acceptant la tyrannie*).
[2] aveugles en votre bien : incapables de voir où réside votre bonheur.
[3] le plus beau et le plus clair de votre revenu : la majeure partie de ce qui vous revient de droit.
[4] s’il n’était d’intelligence avec vous : si vous n’étiez secrètement d’accord avec lui.
[5] receleurs : personnes qui conservent volontairement des objets volés.
[6] larron : voleur.
[7] assouvir sa luxure : satisfaire ses envies de débauche sexuelle.
[8] à la boucherie : à une mort violente (à la guerre).
[9] ministres de ses convoitises : serviteurs de ses désirs.
[10] à vous tenir la bride plus courte : à vous surveiller et vous contrôler plus étroitement.
[11]. ou ne sentiraient point ou n’endureraient point : soit les bêtes seraient insensibles à ces indignités, soit, si elles les ressentaient, elles ne les supporteraient pas.
[12] résolus à : décidés à.
[13] l’ébranliez : le troubliez, le menaciez.
[14] dérobé : retiré, enlevé.
Annonce du plan linéaire
Dans les premières lignes de l’extrait (du début à « de vos familles, de vos vies
» , La Boétie oppose deux idées : d’un côté, le pillage exercé par le tyran ; de l’autre, la passivité complice des peuples.
Puis, de « Et tout ce dégât » à « traîtres à vous-mêmes
», il insiste sur l’absurdité du dévouement des peuples envers un tyran seul, qui ne détient de pouvoir que parce qu’on le lui donne.
Enfin, de « Vous semez vos fruits
» jusqu’à la fin, La Boétie met en contraste l’honnêteté du peuple et les profits injustes du tyran, avant de suggérer une possible voie vers la libération.
I – Des nations entières dépouillées par passivité
A – Aveuglement
Dans une apostrophe passionnée et exclamative, La Boétie interpelle directement ces « peuples insensés
» et ces « nations » entières, désignées au pluriel, en leur parlant à la deuxième personne du pluriel.
Il les qualifie de « pauvres et misérables
» et voudrait les voir sortir du malheur, de l’aveuglement et de l’égarement.
Le jeune humaniste met en lumière l’absurdité de leur situation grâce à un parallélisme : « opiniâtres en votre mal et aveugles en votre bien
». Les adjectifs « opiniâtres » et « aveugles » se répondent tandis que « votre mal » s’oppose à « votre bien ». Ce jeu d’opposition souligne le comportement irrationnel de ces millions d’hommes qui s’entêtent à créer leur propre malheur.
Le thème de l’aveuglement se prolonge dans l’expression « sous vos propres yeux
» (l. 2).
La passivité du peuple se lit dans la tournure : « vous vous laissez confisquer
». Il s’agit bien d’un « laisser faire », sans réaction.
B – Spoliation et passivité
Le champ lexical de la spoliation s’égrène ensuite avec les infinitifs « confisquer », « piller », « voler », « dépouiller » (l. 2-3).
Les objets de ce vol sont matériels : « le plus beau et le plus clair de votre revenu
» (l. 2), formule au superlatif qui désigne les moyens de subsistance ; « vos champs » (l. 2), « vos maisons » (l. 3), « des meubles anciens et paternels
» désignent aussi des possessions personnelles et intimes, et pour cela précieuses, qui ne devraient pas passer dans d’autres mains que celles des héritiers.
La Boétie s’indigne de la dépossession totale dans laquelle les peuples s’abandonnent : « vous vivez de telle sorte que vous ne pouvez vous vanter de posséder quoi que ce soit
» (l. 3-4). L’allitération en [v], vive et vibrante, donne à la phrase un souffle nerveux et souligne la vacuité de cette existence dégradante et servile.
C – Un laisser faire coupable
La Boétie dénonce le manque d’ambition de ses contemporains en imaginant une situation extrême : il les soupçonne – c’est la nuance apportée par les verbes au conditionnel et le verbe « sembler » (« il semblerait que vous verriez maintenant
», l. 4) – de manquer de lucidité au point d’être prêts à payer pour avoir droit de jouir de leurs propres bien.
Il oppose alors deux expressions : l’une très positive, « un grand bonheur
», et l’autre dépréciative « n’être que les locataires de vos biens
» (l. 5). La négation restrictive signale à la fois le manque d’ambition de ces peuples et la hiérarchie entre la situation de locataire et celle de propriétaire.
La situation est d’autant plus absurde que la notion de location entre en contradiction avec le possessif « vos biens ».
L’absurdité culmine dans la gradation finale : « locataires de vos biens, de vos familles, de vos vies
» (l. 5), rendue plus pathétique encore par l’absence de coordination (asyndète) : il ne s’agit donc plus seulement d’une spoliation matérielle, mais d’une dépossession de soi-même et des siens.
Or cette attitude de « laisser faire » est répréhensible, et ces peuples aveugles sont complices de leur propre malheur.
II – Un dévouement irrationnel et paradoxal au tyran
A – Un ennemi solitaire
La Boétie prépare un nouveau paradoxe. Il résume en une gradation de trois termes (« Et tout ce dégât, ce malheur, cette ruine enfin
») l’idée qu’il vient d’exposer : les peuples sont asservis.
Mais il insiste sur un contraste surprenant : tous ces malheurs ne viennent pas de plusieurs ennemis (« non pas des ennemis
», au pluriel), mais d’un seul homme (« mais bien, certes oui, de l’ennemi » , au singulier.
Le singulier, opposé au pluriel, est essentiel ici : comment des nations entières peuvent-elles se soumettre à un seul tyran ? Les adverbes qui renforcent l’affirmation (« certes oui
»), signalent encore l’aspect incompréhensible de la situation.
La Boétie va plus loin : il accuse directement le peuple de fabriquer la grandeur du tyran : « et de celui-là même que vous faites si grand qu’il est
».
Le pronom « vous » est ensuite sujet de tous les verbes : « vous faites », « pour qui vous allez », « pour la grandeur duquel vous ne refusez point
» tandis que le tyran est le bénéficiaire de ces actions : « pour qui », « pour la grandeur duquel
». Le dévouement est donc total, d’autant qu’il s’agit de sacrifier sa vie « à la guerre » : « présenter à la mort vos personnes
» .
B – Le tyran : un homme comme les autres
Pour ouvrir les yeux à ses concitoyens, La Boétie ramène ce maître tyrannique à sa vraie condition : celle de simple être humain.
Les négations restrictives signalent l’idée d’un rabaissement, en opposition à la grandeur dont le tyran jouit dans l’esprit de son peuple : il « n’a pourtant que deux yeux, n’a que deux mains, n’a qu’un corps, et n’a rien de plus » (l. 8-9).
Une gradation inverse marque ce mouvement descendant : de « deux », on passe à « un », puis à « rien ».
L’adjectif superlatif « moindre », dans l’expression « rien de plus que n’ait le moindre habitant » ramène le tyran au niveau même de la personne la plus humble et la plus ordinaire.
C’est l’idée d’égalité entre les êtres humains qui se dessine ici. Le tyran est un homme comme tous les autres.
La Boétie dresse néanmoins une frontière entre le tyran, qui est seul, et les autres hommes, qui sont nombreux : il est seul face au « nombre infiniment grand de nos villes
» .
Enfin, ce tyran « n’a rien de plus […] sinon l’avantage que vous lui fournissez pour vous détruire
» . L’utilisation du pronom « vous », sujet du verbe d’action (« fournissez »), accuse directement les hommes de complicité dans leur propre servitude.
C – La seule origine possible du pouvoir tyrannique
S’ensuit une série de questions rhétoriques qui dressent un portrait fantasmagorique du tyran, monstre aux mille yeux et mille bras qui, partout, surveille, contraint et frappe.
Toutes ces questions ont une structure similaire : elles interrogent l’origine et les moyens du pouvoir du tyran, avec des interrogatifs tels que « d’où a-t-il pris » (l. 10), « d’où les a-t-il
» (l. 12), ou l’anaphore de « comment » en début de phrase.
Elle se poursuit avec une proposition conditionnelle avec une négation restrictive (« si ce n’est », « autrement que », « s’il n’était »…) qui mène à une seule réponse possible : le tyran ne tient son pouvoir que du peuple lui-même. .Tout pointe vers le pronom « vous » : c’est le peuple qui se laisse opprimer.
La première question concerne la surveillance permanente : « D’où a-t-il pris tant d’yeux dont il vous épie
» . La Boétie dénonce la délation et la collaboration des peuples : « si ce n’est pas vous qui les lui donnez
» (l. 10-11). La conditionnelle négative montre l’impossibilité d’une autre source de pouvoir ; le pronom « vous » est sujet du verbe et donc responsable.
La deuxième question porte sur la force de coercition : « Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper
» . La encore, la chute est identique : c’est le pronom « vous » qui est désigné comme origine de la force : « s’il ne les prend de vous
» .
La troisième question, conçue selon la même structure (« Les pieds dont il foule vos cités…
», constate l’omniprésence du tyran en chaque ville et même en chaque personne. Les pieds du tyran sont « les vôtres », donc ceux du peuple.
La quatrième question souligne à nouveau que le pouvoir du tyran vient uniquement du peuple : « Comment a-t-il le moindre pouvoir sur vous, autrement que par vous-mêmes ?
» . Ici, c’est l’usage du superlatif (« le moindre pouvoir
»), allié à la tournure restrictive « autrement que », qui exprime l’état d’extrême paradoxe de la situation ; le pronom « vous » est complément d’agent et donc pleinement impliqué dans l’action.
La cinquième question utilise le conditionnel (« Comment oserait-il
») pour montrer qu’une telle situation serait impossible sans la condition qui suit : « s’il n’était d’intelligence avec vous
». Cette expression pointe du doigt une très claire complicité du bourreau et de ses victimes.
Enfin, la sixième question achève cette démonstration : « Quel mal pourrait-il vous faire
» , encore au conditionnel, s’il n’y avait cette complicité du peuple, exprimée par trois images fortes. Le peuple est :
– « receleur du larron qui vous pille
» : il accepte de cacher celui qui le vole ;
– « complice du meurtre qui vous tue
» : il collabore avec celui qui l’assassine ;
– et surtout, « traître à vous-mêmes
» : il trahit sa propre liberté.
Chaque formule rend plus visible le paradoxe de la servitude volontaire : ce n’est pas le tyran qui impose sa domination, ce sont les peuples qui la rendent possible.
III – L’opposition de l’honnête effort et du profit immoral
A – Les valeurs du travail contre le pillage
La Boétie passe ensuite à des phrases affirmatives.
Il met en contraste deux choses : d’un côté, les efforts honnêtes des hommes asservis ; de l’autre, la débauche et l’ingratitude du tyran.
Le jeune auteur utilise un parallélisme de construction : une proposition principale, est suivie d’une proposition de but introduite par « pour », « pour que » ou « afin que » qui décrit l’immoralité du tyran.
Chaque fois, on observe un décalage fort : le peuple agit avec effort et dévouement, mais le but final profite à un tyran immoral et injuste.
La première image est empruntée à l’agriculture. Elle signifie, de manière métaphorique, que c’est le tyran qui remporte les bénéfices du travail du peuple : « Vous semez vos fruits, pour qu’il les dévaste
».
L’idée du pillage se poursuit avec l’image suivante : « vous meublez et remplissez vos maisons, pour fournir à ses pillages
»
B – Les valeurs morales contre la mort et la luxure
Les dégâts sont matériels, mais aussi moraux, avec le thème du sacrifice des enfants que l’on a pris soin d’élever (c’est le sens du verbe nourrir dans les deux propositions suivantes) : viol pour les filles (« vous nourrissez vos filles, afin qu’il puisse assouvir sa luxure
» ; mort à la guerre pour les garçons (« vous nourrissez vos enfants, afin que […] il les mène en ses guerres
» .
Le possessif « ses » indique qu’il s’agit de guerres dont l’intérêt est personnel et non public.
L’expression située entre tirets (« pour le mieux qu’il leur saurait faire !
») signale que ce sort compte parmi les plus doux, et que la situation peut être pire encore.
Suit alors l’énumération des destinées qui attendent les jeunes sujets du tyran, avec une gradation dans l’avilissement et l’immoralité : mort sanglante et absurde (« qu’il les conduise à la boucherie
», l. 18) ; enrôlement au service de la luxure (« qu’il en fasse les ministres de ses convoitises
» ) ; rôle d’assassin mercenaire (« et les exécuteurs de ses vengeances
» ).
Enfin, revenant toujours à l’idée centrale de servitude volontaire, La Boétie reprend l’image du bourreau de soi-même : « Vous tuez à la tâche vos propres personnes
» , « vous vous affaiblissez
» .
En regard, c’est toujours la débauche du tyran qui profite des efforts de son peuple : « afin qu’il puisse jouir délicieusement et se vautrer dans ses sales et vilains plaisirs
» .
La métaphore empruntée au monde de l’équitation souligne encore une fois que le tyran est rendu puissant par la seule volonté de ses esclaves : « afin de le rendre plus fort et plus rude à vous tenir la bride plus courte
» .
C – Une solution
Une solution se profile pourtant pour les opprimés.
La Boétie indique en effet, en usant d’impératifs, comment sortir de cet asservissement, : « soyez » ; « soutenez
» .
Il emploie le verbe pronominal se délivrer qui signale que la délivrance ne viendra pas de l’extérieur, mais d’eux-mêmes.
La délivrance est en leur pouvoir (« vous pouvez »), et ils en seront les sujets actifs.
Et la chose n’est pas difficile : « si vous essayez, non pas de vous en délivrer, mais seulement de vouloir le faire
» . Il n’est pas tant question d’action mais de volonté.
L’idée clé de volonté est réaffirmée avec le participe passé « résolus » : « Soyez donc résolus à ne plus rester en servitude, et vous voilà libres
» . La simple conjonction de coordination « et », qui relie les deux propositions, invite à croire que cette liberté sera facile et rapide à conquérir.
La Boétie précise qu’il n’est pas question ici de révolution violente contre le pouvoir tyrannique : « Je ne veux pas que vous le poussiez, ni que vous l’ébranliez
» . La solution est plus simple, comme le dit l’adverbe « seulement » : « mais seulement ne le soutenez plus
» (l. 23).
À nouveau, la simple conjonction de coordination « et » en annonce la conséquence directe : « et vous le verrez […] s’effondrer de son propre poids et se briser
» (l. 24-25).
La comparaison au « grand colosse
» qui s’effondre lourdement et se brise illustre l’aspect factice de ce pouvoir qui n’a aucune force vraie et est en réalité très fragile. Il repose entièrement sur cette « base » que lui offre le peuple opprimé.
Conclusion
Deux cents ans avant le Siècle des Lumières, alors que la monarchie absolue régit le royaume de France, le jeune Étienne de La Boétie parle donc d’égalité entre les hommes.
Non, le tyran n’est pas un homme à la puissance surnaturelle : c’est un homme comme les autres, qui n’a pas plus de pouvoir que celui qu’on lui donne. Le tyran est un « larron », un vulgaire voleur.
Tentant d’ouvrir les yeux de ses contemporains, La Boétie use, dans ce passage foisonnant et inspiré, de très nombreuses figures rhétoriques pour mettre en lumière le paradoxe de l’asservissement volontaire au bénéfice d’un tel homme, et pour appeler à une réaction.
Son argument majeur et récurrent est celui de la complicité des peuples, qui, par passivité et crédulité, se rendent coupables de collaboration avec la tyrannie. Ils fabriquent eux-mêmes, de toutes pièces, la grandeur du tyran, et par là-même leur propre malheur.
L’auteur se place alors, détaché de l’ensemble des peuples qu’il interpelle, en observateur, en analyste, puis en conseiller et en homme averti, capable de leur indiquer le chemin de la libération.
Discours de la servitude volontaire : commentaire composé (pour l’écrit du bac de français)
Introduction :
La Boétie écrit Discours de la servitude volontaire en 1547, alors qu’il n ‘a que 18 ans.
L’année 1547 est une année de transition : François Ier, qui avait entrepris une œuvre de centralisation monarchique, meurt et Henri II prend le pouvoir.
A travers son Discours sur la servitude volontaire, La Boétie souhaite envoyer des recommandations à ce nouveau Prince pour l’engager à une conception nouvelle de la monarchie.
I – Un réquisitoire contre la monarchie
La Boétie fait un véritable réquisitoire contre la monarchie qu’il juge injuste et confiscatoire. Le monarque est un voleur (A) et la monarchie une tragédie (B)
(NB : un réquisitoire est un discours accusateur tenu par le procureur dans le cadre d’un procès)
A – Le monarque, un voleur
Dans Discours de la servitude volontaire, le roi est déprécié.
Le roi, qui est censé être un être exceptionnel, n’est mentionné qu’à travers des pronoms démonstratifs sans être nommé ou spécifié : « celui-là », « celui pour qui… et pour la grandeur duquel
».
Son corps, considéré comme sacré au 16ème siècle, est ramené à un corps quelconque à travers le registre réaliste « deux yeux, deux mains, un corps
».
Ce vocabulaire surprend car à cette époque, seul le registre épique est toléré pour évoquer le roi et ce dernier ne peut être comparé qu’à des êtres mythologiques. Or ici, le registre est réaliste et le roi est diminué à travers une tournure restrictive « Ce maître n’a pourtant que …
».
La périphrase « ce maître
» est elle aussi dépréciative car elle ramène le roi à une fonction, un métier alors que ce statut relève normalement de l’élection divine.
Mais La Boétie va envore plus loin : il dresse du roi le portrait d’un voleur.
Le champ lexical du vol est très présent : « pauvres gens misérables », « enlever sous vos yeux », « piller », « dépouiller », « rien n’est plus à vous », « la moitié de vos biens », « larron qui vous pille », « ses pilleries
».
Ce champ lexical du vol est mis en valeur par la démultiplication de l’adjectif possessif de la deuxième personne du pluriel qui marque la propriété : « votre revenu », « vos champs », « vos maisons », « vos ancêtres », « vos biens », « vos familles », « vos vies
».
Ces propriétés sont évoquées à travers une gradation : le Roi confisque les biens de son peuple à travers l’impôt (« vos revenus
« ), mais il vole aussi des biens immatériels comme la vie (« vos vies
« ).
Ce texte s’apparente donc bien à un procès dans lequel La Boétie accuse le roi.
On retrouve d’ailleurs dans le texte une rhétorique judiciaire, comme par exemple le rythme ternaire suivi d’un rythme binaire au début du texte : « Pauvres gens misérables, peuples insensés, nations opiniâtres à votre mal (1) et aveugles à votre bien
(2) ! » .
(1) Le rythme ternaire est un crescendo classique dans la rhétorique judiciaire partant des individus pour s’élargir aux nations.
(2) Le rythme binaire met en balance le mal et le bien comme le ferait un juge.
B – La monarchie, une tragédie
Dans ce texte, le registre pathétique est très présent, à travers notamment le champ lexical du malheur : « dégâts », « malheur », « ruine », « mort », « détruire », « indignités
».
Les déterminants démonstratifs rendent encore plus présents et réels les éléments pathétiques : « ces dégâts, ces malheurs, cette ruine
» .
Si quelques termes caractérisent le peuple de façon épique (« courageusement », « grandeur », « vous offrir vous-mêmes à la mort
» ), ils sont déconstruits par le terme « boucherie » qui souligne qu’il s’agit d’un héroïsme inutile dont le roi est indigne (« pour qu’il les mène à la guerre, à la boucherie
» ).
Mais le plus tragique réside dans le fait que c’est le peuple lui-même qui est à l’origine de cette souffrance. C’est ce que montre l’analyse grammaticale des pronoms personnels « vous » :
♦ « Ce qu’il a de plus, ce sont les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire »
»
♦ « Quel mal pourrait-il vous faire, si vous n’étiez les receleurs du larron qui vous pille, les complices du meurtrier qui vous tue et les traîtres de vous-mêmes
Dans ces phrases, le pronom « vous » est tantôt sujet tantôt objet. Cette alternance souligne que le peuple est à la fois sujet et objet de son malheur. Il s’enferme lui-même dans une circularité tragique – celle de la servitude volontaire.
Transition : Ce réquisitoire contre la monarchie s’inspire aussi de la rhétorique du sermon (= des prédications réalisées au cours de la messe).
II – Un sermon
A – Une rhétorique ecclésiastique
On trouve dans cet extrait une rhétorique ecclésiastique (= propre à l’Église).
Tout d’abord, la situation d’énonciation met en œuvre un « je » qui, comme un directeur de conscience, s’adresse à un « vous » omniprésent.
L’auteur cherche à bousculer son auditoire comme en témoigne l’apostrophe dépréciative : « Pauvres gens misérables, peuples insensés, nations opiniâtres
» et la modalité exclamative et interrogative très présente dans le texte.
Ensuite, on retrouve les étapes clés d’un discours rhétorique :
♦ L’exorde (début du discours rhétorique) : il s’agit de l’apostrophe initiale.
♦ La narration (deuxième partie du discours rhétorique) qui rappelle comment le peuple en est arrivé à cet état de servitude.
♦ La digression qui apparaît à travers les 6 questions impliquant l’auditoire dans le discours.
♦ La péroraison (conclusion du discours) dans laquelle La Boétie exhorte le peuple à se révolter comme le montre l‘impératif au début du dernier paragraphe : « Soyez résolus à ne plus servir
» .
B – La Boétie, un directeur de conscience
La Boétie se transforme donc en directeur de conscience qui cherche à sauver les âmes.
Le rythme ternaire omniprésent inscrit la trinité dans la stylistique du texte :
♦ « Pauvres gens misérables, / peuples insensés, / nations opiniâtres»
»
♦ « Et tous ces dégâts, / ces malheurs, / cette ruine
La rhétorique religieuse se retrouve aussi dans images choisies, proches des paraboles évangéliques : « vous semez vos champs », « vous nourrissez vos enfants
».
Le texte prend en outre une dimension morale à travers le champ lexical du plaisir qui évolue vers la luxure : « mignarder », « délices », « vautrer », « sales plaisirs
».
Le roi est coupable des péchés capitaux et La Boétie montre qu’en acceptant sa domination, le peuple s’éloigne des valeurs évangéliques.
La Boétie veut donc montrer au peuple sa responsabilité dans cette servitude et faire germer en lui la volonté de reprendre en main son destin (« seulement de le vouloir
»).
III – La philosophie politique de La Boétie
A travers cette exhortation à la révolte populaire, La Boétie répond à une question de plus en plus posée à l’époque : quel est le meilleur gouvernement possible ?
A – L’Etat monarchique, un monstre
La Boétie donne de l’Etat une image monstrueuse.
L’Etat est comparé à Argus, le géant de la mythologie grecque aux cent yeux : « D’où tire-t-il tous ces yeux qui vous épient, si ce n’est de vous ?
».
La comparaison « tel un grand colosse dont on a brisé la base
» rappelle le colosse aux pieds d’argile dans la Bible, (« Daniel ») dont l’invincibilité apparente cache une grande fragilité.
Ces comparaisons mettent en valeur la monstruosité de l’Etat monarchique qui vampirise son peuple, s’en nourrit en n’ayant pour seule fin que lui-même.
L’omniprésence des propositions subordonnées exprimant le but souligne que les sujets ne sont que des moyens au service de la puissance du Roi :
♦ « afin qu’il puisse assouvir sa luxure[…]
♦ pour qu’il en fasse des soldats […]
♦ pour qu’il les mène à la guerre[…]
♦ afin qu’il puisse se mignarder dans ses délices […] afin qu’il soit plus fort »
Aveugle au bien commun, l’Etat monarchique ne sert donc que son seul intérêt.
Il serait hasardeux de penser que La Boétie rejette la monarchie. En revanche, il souhaite une monarchie qui ne soit plus de droit divin mais qui soit fondée sur le respect mutuel entre le monarque et ses sujets.
B – La théorie naissante du contrat social
A l’époque de la Boétie, le pouvoir politique venait de Dieu, de manière héréditaire, dans le cadre d’une monarchie absolue de droit divin.
La Boétie sort de ce schéma en posant la question « A-t-il pouvoir sur vous qui ne soit de vous-mêmes ?
».
En songeant à un pouvoir qui serait issu du peuple (et non de Dieu), La Boétie anticipe les théories du contrat social qui seront développées par Hobbes (17ème siècle) et Rousseau (18ème siècle) selon lesquelles la société politique naît d’un contrat entre les hommes qui acceptent de renoncer à certaines libertés en échange d’une protection de l’Etat.
La Boétie, dans ce texte, passe d’une conception pyramidale et hiérarchisée du pouvoir à une conception contractuelle (= le pouvoir envisagé comme un contrat entre le peuple et celui qui gouverne).
Discours de la servitude volontaire, La Boétie, conclusion :
La Boétie écrit en 1547 un texte d’une fascinante précocité.
Il pose, à 18 ans seulement, les fondements de la théorie du contrat social qui sera mise en place par des auteurs comme Hobbes au 17ème siècle et par Rousseau au 18ème siècle.
Mais le chemin est encore long : ce texte virulent, écrit en 1547, sera publié clandestinement en 1576 et oublié pendant plusieurs siècles avant d’être redécouvert au 19ème et 20ème siècle.
Tu étudies Discours de la servitude volontaire de La Boétie ? regarde aussi :
♦ Discours de la servitude volontaire : dissertation corrigée
♦ Discours de la servitude volontaire, exposé du sujet (début) (analyse linéaire)
♦ Discours de la servitude volontaire, extrait 2 (l’habitude de la servitude) (analyse linéaire)
♦ Discours de la servitude volontaire, la liberté est naturelle (analyse linéaire)
♦ Discours de la servitude volontaire, les ruses pour maintenir le peuple en servitude (analyse linéaire)
♦ Discours de la servitude volontaire, le secret du maintien de la servitude (analyse linéaire)
♦ Montaigne, « Des cannibales » (analyse)
♦ Montaigne, « Des coches » (analyse)
♦ Damilaville, article Paix (analyse)
♦ Montesquieu, Lettres persanes 24 (analyse)
Les 3 vidéos préférées des élèves :
- La technique INCONTOURNABLE pour faire décoller tes notes en commentaire [vidéo]
- Quel sujet choisir au bac de français ? [vidéo]
- Comment trouver un plan de dissertation ? [vidéo]
Tu entres en Première ?
Commande ton livre 2026 en cliquant ici ⇓

En Troisième ?
Ton livre pour le Brevet ici ⇓


J’ai juste un petite question,
pour la problématique, je me suis inspirée d’une de celles proposées en haut de la page et j’ai fait la problématique suivante : Que reproche La Boétie à la monarchie et au peuple et quelle solution prône t-il?
Pouvez-vous me donner votre avis? Merci par avance!
Bonjour Amélie,
merci à vous de tenir ce site, vous m’avez littéralement sauvé la vie car je ne comprenais pas bien ce texte (c’est un de ceux qu’on a le moins étudié en classe). Grâce à vous je crains moins l’éventualité de tomber dessus au Bac.
Merci beaucoup!
Merci pour ton retour Célia !
Mais pourquoi son attitude servile envers les tyrans est-elle incompréhensible pour La Boétie?
Bonjour Aurelie,
Tout d’abord merci pour votre analyse hyper complète et claire.
Pour ma part, ma professeure de français nous a fait une analyse en 5 grandes parties sans sous-parties… j’ai donc peur (si je tombe sur ce texte à l’oral du bac de français) de ne pas respecter une analyse « classique » en 3 parties…
Merci par avance pour votre réponse
Bonjour Chloé,
Le nombre de parties n’est pas fondamental dans une analyse linéaire, qui cherche à rendre compte des mouvements du texte. Tu peux donc suivre le plan proposé par ton enseignante pour l’oral.
Bonjour,
j’ai étudié un extrait du Discours de la servitude Volontaire cette année (1ere S) et j’aimerai savoir si vous avez d’autres idées d’ouvertures pour ce texte car je n’en trouve pas à part que cet essai est toujours d’actualité?
Merci d’avance.
Ma remarque est d’ordre général : je suis régulièrement frappé par la rigueur de vos analyses et la pertinence des relations que vous établissez avec d’autres ou auteurs. Merci !
Merci Nacer ! Je passe en effet du temps sur ces commentaires car j’ai à cœur de vous proposer un travail synthétique mais de qualité, qui vous aide à contextualiser l’oeuvre et à faire le lien avec d’autres auteurs !
Merci beaucoup pour cette analyse très bien construite et très intéressante !
Mon professeur de cette année étant très inégal dans ses analyses et ne nous donnant aucune méthode, j’ai été très heureuse de tomber sur ce blog. Je viens de m’inscrire à la formation et je suis vraiment ravie des conseils que vous pouvez nous donner.
Pour le Discours de la servitude volontaire plus spécifiquement, nous l’avions étudié dans le thème de la littérature de combat, avec le Parti du crime de Victor Hugo (Les Châtiments) et Le Mariage de Figaro de Beaumarchais (III, 16) en nous intéressant surtout à l’aspect polémique des textes.
L’angle d’approche pour le texte de La Boetie donné par notre professeur était comment La Boetie proposait non pas une attaque envers une personne en particulier mais plutôt une critique collective, avec une généralisation historique (ouverture sur Hitler notamment). Ainsi, il mettait l’accent sur la manière dont La Boetie soulignait que le peuple était aussi coupable que le tyran.
J’avoue que cette approche me semblait un peu complexe, et il n’avait pas du tout ouvert sur la théorie du contrat social (du moins pas explicitement, mais j’avais peut-être simplement pas compris ce qu’il essayait de nous expliquer), et l’aspect sermon n’avait pas du tout été évoqué. Ce qui me posait problème étant surtout le manque de procédés rhétoriques examinés (à peine trois) pour un objectif de compréhension, puis d’écriture, de littérature de combat.
En revanche, il proposait pour le tyran que cible ce texte une alternative intéressante : le connétable de Montmorency – il y avait eu des soulèvements populaires contre la gabelle à Bordeaux en 1548. J’avoue ne pas être allée vérifier une quelconque causalité. Tooutefois, même en ciblant le connétable, le roi reste définitivement aussi coupable : après tout, c’était lui qui avait imposé l’impôt.
Notre professeur étant un adorateur de paradoxes, il en a souligné plusieurs dans le texte – rien que dans le titre par exemple – en expliquant qu’user de ce procédé permettait de souligner un non-sens et par conséquent faire réfléchir le peuple sur ses actions. A utiliser dans un développement où le peuple est aussi coupable que le tyran, je pense.
La conclusion de l’analyse que j’avais étant que La Boetie voulait secouer le peuple, non pas en lui faisant renverser le tyran mais en éclairant les fondements de la tyrannie pour qu’elle s’écroule toute seule, ainsi que le colosse aux pieds d’argile. Ce qui est assez intemporel, expliquant ses réutilisations ; mais sans méthode, nous n’avons pas su l’adapter aux diverses questions d’oral que nous avons eu au blanc.
Enfin, il me semble important de préciser que si le texte, à l’origine publié dans les essais de Montaigne, est passé totalement inaperçu lors de sa publication originale, il a surtout été réutilisé lors des guerres de religions par le parti des protestants – mais cela ouvre encore plus de complexité à l’affaire, non ?
Voilà, en espérant avoir apporté un peu en retour de tout ce que j’ai reçu grâce à cette analyse, et en vous remerciant encore. ^^
Bonjour Elaine,
Merci pour tes remarques très intéressantes qui enrichiront aussi les analyses des autres élèves !
Vous me sauvez la vie c’est tellement parfait mdr merci beaucoup
TB mais il semble que vous confondiez monarchie et tyrannie, monarque et tyran… La monarchie française du XVIe siècle n’avait rien de tyrannique …
Il n’y a aucune confusion. La Boétie critique avec virulence la monarchie absolue de droit divin, la jugeant monstrueuse et presque vampirique. C’est bien à la monarchie qu’il adresse ses griefs.
super site ! vraiment bravo 😉
Bonjour Amelie,
Avant tout, merci pour le travail que tu fais pour nous aider, c’est vraiment gentil
J’aimerais savoir ce qu’est le contrat social chez Rousseau et Hobbes car j’ai fait quelques recherches sur internet j’ai trouvé cela assez compliqué à comprendre et on ne sait jamais is on me pose la question le jour de l’entretien.
Merci d’avance
chere madame Amelie,
je suis une eleve de la 1ere S et je passe l’epreuve le 12 juin. malheuresemet ma prof cette annee nous a pas donne toutes lectures analytiques inclus deux de la boetie. la boetie rtant un essais tres difficile à analyser pour cela si vous pouvez m’aider sur les deux extraits:
– page 24-25-26 de « caton l’utiquain » » jusqu’a » la coutume »
– page 45-46-47 de « c’est cela que » jusqu’a « peine paticuliere »
vous pouvez sauver mon epreuve
j’espere avoir une reponse assez vite vu que le temps passe
merci d’avance
bonjour je voudrais savoir si le plan de cette œuvre répond à toutes les problématiques proposées pour cette œuvre merci
Mes plans répondent aux questions possibles, mais tu dois apprendre à adapter ton plan à la question posée comme je vous le montre dans cette vidéo.
Je suis prof de français et je suis impressionnée par la qualité, la rigueur et, bien sûr, la pertinence de vos analyses. Bravo !
Bonjour, j’ai trouvé votre analyse de l’œuvre de la Boetie vraiment intéressante (l’extrait commenté en tout cas). Je suis en classe préparatoire scientifique en fait et cette année le thème est « servitude et soumission » et l’une des trois œuvres au programme est justement la Boetie. Quel conseil pourriez-vous me donner pour analyser le Discours de la Boetie en se concentrant sur l’Histoire et son impact sur la soumission des peuples ?
Bonjour, moi aussi je dois étudier le Discours de la Boétie en se concentrant uniquement sur l’Histoire. As-tu trouvé des pistes ? Car je n’arrive pas à construire un plan qui ne soit pas descriptif…
Bonjour Amélie,
je vais régulièrement sur ton site et ne laisse jamais de commentaire mais je pense qu’il faut que je le fasse tout simplement pour te remercier.
Ton site est complet, tu expliques super bien et franchement un grand bravo pour tout ce travail qui doit te demander beaucoup de temps.
Etant en première L, je me suis inscrite sur tous tes programmes (10 leçons et le programme payant) et grâce à toi, j’ai augmenté ma moyenne en francais de 3 points !
Et merci pour les textes commentés car je m’en inspire énormément pour mon oral.
Bravo et merci!
Bonjour Loïs,
Merci d’avoir pris le temps de m’écrire. Je suis ravie de lire que les deux formations te plaisent et que le site te permet de préparer ton oral plus sereinement. A bientôt !
Re-Bonjour Amélie ,
Je vous prie d’excuser le retard de ma réponse ^^ et merci de la vôtre le 11 avril .
Selon vous , combien d’oeuvres faut-il connaitre en moyenne pour le Bac ?
À part poésie , roman et théâtre , y a t-il d’autres grands » genres » à connaître ?
Merci de vos réponses 😉
PS: petite suggestion pour le site : peut être plus de quizz ( ceux deja presents sont bien réalisés ! ) , et une petite barre de recherche , sinon ne changez rien, c’est génial !! 😀
Bonjour Diane,
Effectivement, j’aime beaucoup créer des quiz pour vous; je compte en faire davantage cet été. Quand à la barre de recherche, il y en a bien une dans la barre latérale de droite !
Je suis en classe de 1ère L et pendant ces vacances d’avril je prépare toute mes fiches pour mes documents complémentaires, sur les mouvements et tous ce qu’il faut savoir et je viens de tomber sur votre site qui est vraiment géniale.
Grâce à la vidéo sur le sonnet de Baudelaire « Correspondances » j’ai facilement pu faire une fiche simple et fournie et je viens de voir que plusieurs textes étudiés en cours sont sur le site donc je vais pas mal l’utiliser pour les fiches de mes documents complémentaires !
Donc merci ☺
Merci pour ton message 🙂
Bonjour ,
Je suis tout à fait d’accord avec Laura ! Continez comme ça, cela nous aide bcp 😉
Mais j’ai une question :
Étant par correspondance et préparant mon bac seule sans être inscrite dans un établissement donc pas de prof sauf ma famille pour les bons conseils et leurs connaissances.
( ne le prenez surtout pas mal ! Je decouvre . ) – Mais est ce que votre site donne les oeuvres à lire pour cette année où vous le faites un peu au hasard ? ^^
– Quels sont selon vous les principales oeuvres à étudier pour Juin 2016 ?
– Les articles les plus lus sur le côté sont ils vraiment les plus lus ou ce sont des articles arrivés par automatismes électroniques ?
Merci de vos réponses ( au final j’en avais plusieurs ^^)
À bientôt pour de nouveaux Commentaires Composés 😀
Bonjour Diane,
Il n ‘y a pas d’œuvres au programme en classe de Première. Pour l’oral, les professeurs élaborent eux-même un descriptif de lecture en choisissant des extraits d’oeuvres qui illustrent les différents objets d’étude. Sur mon site, je commente des classiques de la littérature française que beaucoup d’élèves retrouvent dans leur liste d’oral, mais il n ‘y a pas un programme d’oeuvres précises à connaître.
Je change régulièrement la barre latérale de droite. Pour le moment, les articles qui apparaissent sur le côté font partie des 150 articles les plus vus sur mon site. A bientôt !
Effectivement comme elle a dit Amélie c’est très enrichissant. J’en ai profité pour travailler mon sujet de devoir sur Boétie la servitude volontaire. Merci pour cet analyse.
Votre site est une pépite !!