Tu passes le bac de français ? CLIQUE ICI et deviens membre de commentairecompose.fr ! Tu accèderas gratuitement à tout le contenu du site et à mes meilleures astuces en vidéo.
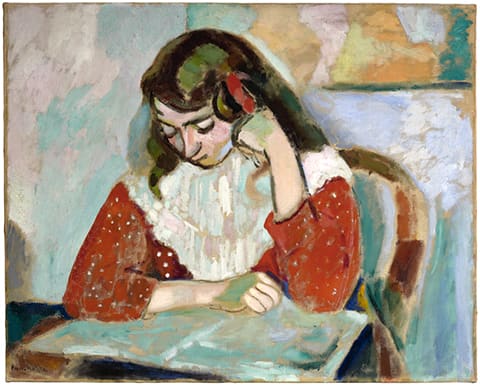
Voici une lecture linéaire de la lettre 9 de Lettres d’une Péruvienne de Françoise de Graffigny.
L’extrait étudié va de « Depuis deux jours, j’entends plusieurs mots de la langue du cacique » à « et je me trouve sans cesse dans la plus profonde obscurité
»
Lettre IX, introduction
Le roman épistolaire Lettres d’une Péruvienne – paru d’abord anonymement en 1747– de Françoise de Graffigny raconte la vie de Zilia, une princesse inca enlevée à son fiancé Aza par des conquistadors espagnols, ramenée de force en Europe.
À la suite d’une bataille remportée par les Français, elle est sauvée par le capitaine Déterville qui s’éprend d’elle.
Oscillant entre l’espoir de retrouver son fiancé resté au Pérou et sa découverte d’une culture différente, Zilia écrit des lettres qui rendent compte de ses émotions et de son statut de femme. (Voir la fiche de lecture pour le bac de français sur Lettres d’une Péruvienne)
Dans cette lettre 9, le lecteur découvre les tentatives de compréhension du monde occidental et les émotions contradictoires qui l’animent.
Extrait étudié – Lettre 9
Depuis deux jours, j’entends plusieurs mots de sa Langue du Cacique que je ne croyais pas savoir. Ce ne sont encore que des termes qui s’appliquent aux objets, ils n’expriment point mes pensées et ne me font point entendre celles des autres ; cependant ils me fournissent déjà quelques éclaircissements qui m’étaient nécessaires.
Je sais que le nom du Cacique est Déterville, celui de notre maison flottante vaisseau, et celui de la terre où nous allons, France.
Ce dernier m’a d’abord effrayée : je ne me souviens pas d’avoir entendu nommer ainsi aucune Contrée de ton Royaume ; mais faisant réflexion au nombre infini de celles qui le composent, dont les noms me sont échappés, ce mouvement de crainte s’est bientôt évanoui ; pouvait-il subsister longtemps avec la solide confiance que me donne sans cesse la vue du Soleil ? Non, mon cher Aza, cet astre divin n’éclaire que ses enfants ; le seul doute me rendrait criminelle ; je vais rentrer sous ton Empire, je touche au moment de te voir, je cours à mon bonheur.
Au milieu des transports de ma joie, la reconnaissance me prépare un plaisir délicieux, tu combleras d’honneur et de richesses le Cacique bienfaisant qui nous rendra l’un à l’autre, il portera dans sa Province le souvenir de Zilia ; la récompense de sa vertu le rendra plus vertueux encore, et son bonheur fera ta gloire.
Rien ne peut se comparer, mon cher Aza, aux bontés qu’il a pour moi ; loin de me traiter en esclave, il semble être le mien ; j’éprouve à présent autant de complaisances de sa part que j’en éprouvais de contradictions durant ma maladie : occupé de moi, de mes inquiétudes, de mes amusements, il paraît n’avoir plus d’autres soins. Je les reçois avec un peu moins d’embarras, depuis qu’éclairée par l’habitude et par la réflexion, je vois que j’étais dans l’erreur sur l’idolâtrie dont je le soupçonnais.
Ce n’est pas qu’il ne repète souvent à peu près les mêmes démonstrations que je prenais pour un culte ; mais le ton, l’air et la forme qu’il y emploie, me persuadent que ce n’est qu’un jeu à l’usage de sa Nation.
Il commence par me faire prononcer distinctement des mots de sa Langue. (Il sait bien que les Dieux ne parlent point) ; dès que j’ai répété après lui,
oui, je vous aime, ou bien, je vous promets d’être à vous, la joie se répand sur son visage, il me baise les mains avec transport, et avec un air de gaieté tout contraire au sérieux qui accompagne l’adoration de la Divinité.Tranquille sur sa Religion, je ne le suis pas entièrement sur le pays d’où il tire son origine. Son langage et ses habillements sont si différents des nôtres, que souvent ma confiance en est ébranlée. De fâcheuses réflexions couvrent quelquefois de nuages ma plus chère espérance : je passe successivement de la crainte à la joie, et de la joie à l’inquiétude.
Fatiguée de la confusion de mes idées, rebutée des incertitudes qui me déchirent, j’avais résolu de ne plus penser ; mais comment ralentir le mouvement d’une âme privée de toute communication, qui n’agit que sur elle-même, et que de si grands intérêts excitent à réfléchir ? Je ne le puis, mon cher Aza, je cherche des lumières avec une agitation qui me dévore, et je me trouve sans cesse dans la plus profonde obscurité.
Problématique
Comment cette lettre, à travers le regard étranger de Zilia, montre-t-elle que la langue française lui permet peu à peu de comprendre le monde occidental, alors inconnu à la jeune femme ?
Plan linéaire
Nous analyserons tout d’abord la découverte progressive de la langue française par Zilia, puis le regard naïf qu’elle porte sur la civilisation française.
Enfin, nous nous pencherons sur le portrait complexe de Déterville qui transparaît dans cette lettre.
I – Une découverte progressive du langage et de la culture occidentale
De « Depuis deux jours, j’entends plusieurs mots de la langue » à « où nous allons, France
»
L’extrait étudié s’ouvre sur un complément circonstanciel (« depuis deux jours ») qui indique que Zilia se repère dans le temps et entend « plusieurs mots de la langue du Cacique ».
L’usage du terme « Cacique » et sa typographie en italique souligne qu’il s’agit d’un terme emprunté à son univers amérindien, le cacique étant un chef de tribu. Elle s’appuie ainsi sur ses propres repères pour tenter de décoder et déchiffrer un nouvel univers.
Le champ lexical de la connaissance illustre l’impérieux besoin pour Zilia de comprendre le monde qui l’entoure : « j’entends », « savoir », « termes », « pensées », « entendre », « éclaircissements »
.
Sa curiosité d’esprit et son ouverture à une nouvelle culture sont explicites : le balancement binaire (« ils n’expriment point…cependant ils me fournissent déjà
») indique combien Zilia est soucieuse de comprendre son environnement. Pour l’instant, sa compréhension se limite au nom des « objets« , alors qu’elle désire pouvoir exprimer sa pensée.
Elle fait des rapprochements entre les mots. La proposition subordonnée conjonctive complétive qui commence par « Je sais que » illustre, par trois exemples concrets, son apprentissage du vocabulaire : « Je sais que le nom du Cacique est Déterville, celui de notre maison flottante vaisseau, et celui de la terre où nous allons, France.
»
Cette syntaxe de l’énumération produit un effet de candeur qui prête à sourire, comme si Zilia récitait une leçon apprise par coeur. Elle aligne des mots isolés, sans les mettre encore en rapport. Ainsi, on passe d’un nom propre individuel (« Déterville ») à un substantif commun (« vaisseau »), puis à un nom chargé de solennité politique et historique (« France »). La progression est incongrue : elle met sur le même plan le nom d’un homme, celui d’un objet matériel, et celui d’une nation entière.
De plus, pour le lecteur français du XVIIIᵉ siècle, il y a un léger comique de perspective : l’héroïne traite le nom de « France » comme exotique, inconnu, alors qu’il est pour le lecteur familier et évident. Graffigny renverse les rôles : ce n’est plus l’Européen qui découvre avec condescendance les noms du Nouveau Monde, mais la Péruvienne qui s’étonne devant nos propres mots. Ce décalage ironique a aussi une portée critique : il invite le lecteur français à prendre conscience de sa propre étrangeté vue de l’extérieur.
II – Le regard naïf de Zilia, ou l’ironie tragique
De « Ce dernier m’a encore effrayée » à « son bonheur fera ta gloire
»
L’effet comique que nous avons analysé cède immédiatement à un registre plus grave. En effet, Zilia confie aussi sa peur vis-à-vis de la « France » à travers le participe passé « effrayée » et le groupe nominal « ce mouvement de crainte ».
Elle en explique les raisons : son appréhension vient de son ignorance (« je ne me souviens pas d’avoir entendu nommer ainsi », « dont les noms me sont échappés
»). Un nouveau mot est donc plus qu’une nouvelle sonorité : il désigne une nouvelle réalité.
A ce stade, Zilia se rattache à ce qu’elle connaît, c’est-à-dire un univers limité : la « Contrée de ton Royaume
». Elle interprète tout à travers sa grille de référence inca.
La conjonction adversative « mais » indique qu’elle fait appel à sa raison pour chasser sa peur. C’est ce que confirme la proposition participiale « faisant réflexion au nombre infini de celles qui le composent
». La conséquence est alors exprimée de la façon suivante : « ce mouvement de crainte s’est bientôt évanoui.
» La justification est fragile : si elle ne connaît pas le nom de « France », c’est parce qu’elle ne peut se souvenir de toutes les provinces du royaume d’Aza. Ce raisonnement, en apparence logique, reste donc pourtant une illusion.
La jeune fille se repère par rapport aux éléments qu’elle connaît. L’interrogation « pouvait-il subsister longtemps avec la solide confiance que me donne sans cesse la vue du Soleil ?
» montre combien non seulement la nature lui sert de repère rassurant, mais aussi le destinataire de ses lettres, Aza, mis en valeur par l’expression hypocoristique « mon cher Aza
».
Le soleil est désigné par la périphrase « cet astre divin », réminiscence de sa culture inca, et est doté d’une fonction : éclairer les enfants – expression qui peut se lire au sens premier et au sens figuré car la lumière symbolise la connaissance.
Le passage bascule dans un lyrisme exalté, marqué par l’apostrophe : « Non, mon cher Aza
». Le ton amoureux s’unit à l’élan religieux : « cet astre divin n’éclaire que ses enfants
».
Suit une phrase scandée par des anaphores verbales : « je vais rentrer… je touche… je cours…
». Le rythme ternaire, l’effet de gradation et la parataxe (absence de mots de liaison) miment l’accélération du cœur. La jeune femme est d’une naïveté touchante car est persuadée de rentrer au Pérou; alors que le lecteur sait qu’elle est captive d’un navire français.
Le champ lexical du bonheur est ainsi omniprésent : « transports », « ma joie », « plaisir délicieux », « combleras », « bonheur ». En effet, Zilia est habitée par l’espoir de retrouver Aza, grâce au « Cacique
» qu’elle qualifie naïvement de « bienfaisant ». Cet adjectif qualificatif exprime la reconnaissance qu’elle lui porte.
L’ironie tragique est à l’œuvre car le lecteur comprend que Zilia est crédule : à ses yeux, Déterville sera l’artisan des retrouvailles amoureuses avec Aza. Sa certitude transparaît dans le futur simple de la proposition subordonnée relative « qui nous rendra l’un à l’autre ».
Le futur (« tu combleras
») projette la reconnaissance vers Aza. C’est encore à travers le fiancé que se construit la perspective d’action, comme si Zilia n’avait pas de pouvoir propre. On retrouve ainsi sa vision patriarcale et hiérarchisée du monde : seul Aza, souverain, est en mesure de récompenser Déterville.
III – Un portrait de Déterville complexe
De « Rien ne peut se comparer » à la fin de l’extrait
Zilia exprime sa gratitude pour Déterville et en fait un portrait élogieux qui s’ouvre de façon hyperbolique avec l’expression « Rien ne peut se comparer ».
Le terme « bontés » oriente le portrait du côté de la douceur, de la générosité. L’emploi du pluriel donne l’idée d’une profusion de gestes de sollicitude.
Le balancement binaire « loin de me traiter en esclave, il semble être le mien
» crée un renversement ironique. Le lecteur comprend que Déterville fait la cour à Zilia. Elle souligne l’attention que lui porte le chevalier à travers une énumération ternaire appuyée par l’allitération en [m] : « occupé de moi, de mes inquiétudes, de mes amusements
».
Cette dernière se dit « éclairée par l’habitude et par la réflexion
» ; elle gagne en connaissance comme l’indique la proposition subordonnée conjonctive complétive : « je vois que j’étais dans l’erreur sur l’idolâtrie dont je le soupçonnais.
»
Pourtant, le lecteur comprend qu’elle est encore confuse devant les démonstrations amoureuses du Chevalier. Elle tente en effet de les qualifier, en oscillant entre rituel religieux et jeu.
La litote (« ce n’est pas qu’il ne répète pas
») atténue pour mieux souligner la fréquence des gestes du Chevalier. Le terme « démonstrations » reste volontairement vague, pouvant désigner aussi bien des manifestations d’affection que des rituels religieux. Cette polysémie entretient la confusion initiale de Zilia.
L’expression restrictive « ce n’est qu’un jeu
» minimise la portée de ces gestes et atténue la menace religieuse : on passe du sacré au ludique. Toutefois, le syntagme « à l’usage de sa Nation » replace ce « jeu » dans un cadre collectif : il n’est pas seulement individuel, mais culturel. L’héroïne tente ainsi de faire une lecture ethnographique des français, qui ne peut manquer de faire sourire le lecteur.
Déterville semble se comporter comme un pédagogue avec des desseins inavouables : sa capacité à manipuler la jeune fille ignorante est claire dans la phrase « Il commence par me faire prononcer distinctement les mots de sa Langue
».
Il fait répéter à Zilia des phrases lourdes de sens et de conséquences : « oui, je vous aime », « je vous promets d’être à vous
». Le contraste entre le contenu explicite (des aveux d’amour et de fidélité) et l’inconscience de Zilia qui les répète mécaniquement est source d’ironie dramatique : le lecteur comprend bien mieux qu’elle la situation.
La réaction de Déterville ne se fait pas attendre : « la joie se répand sur son visage, il me baise les mains avec transport, et avec un air de gaieté tout contraire au sérieux qui accompagne l’adoration de la Divinité.
»
L’opposition entre « tranquille » et « je ne le suis pas entièrement » souligne le déplacement de l’angoisse : la menace de Déterville disparue, elle se voit remplacée par une inquiétude politique ou géographique.
Son trouble est renforcé par les différences culturelles comme l’indique la proposition subordonnée circonstancielle de conséquence « Son langage et ses habillements sont si différents des nôtres que souvent ma confiance en est ébranlée.
». Le déterminant possessif « ses » s’oppose au « nôtres », qui inclut Zilia et son monde d’origine, et marque la fracture entre deux univers.
La présence de la négation « je ne le suis pas entièrement
», et de termes à connotation péjorative (« ébranlée », « fâcheuses », la métaphore « nuages », « crainte », « inquiétude »
) montrent que Zilia se sent déchirée. La construction en chiasme de l’expression « je passe successivement de la crainte (A) à la joie (B), et de la joie (B) à l’inquiétude
» souligne combien ses émotions sont changeantes.
Elle oscille entre des émotions contradictoires, comme le soulignent les deux propositions participiales « Fatiguée de la confusion de mes idées, rebutée des incertitudes qui me déchirent
». La jeune femme souffre et ne voit pas d’autre issue que « de ne plus penser
». Son désarroi se fait de plus en plus intense ; c’est ce qu’illustre l’interrogation rhétorique « comment ralentir le mouvement d’une âme privée de toute communication, qui n’agit que sur elle-même, et que de si grands intérêts excitent à réfléchir ?
»
Le groupe nominal « une âme privée de toute communication
» insiste sur l’isolement de l’héroïne, qui amplifie son agitation intérieure. La phrase est longue et complexe, ce qui reproduit le tumulte mental de Zilia et son incapacité à se calmer.
L’extrait s’achève par une affirmation d’impuissance exprimée par la négation grammaticale (« Je ne le puis« ).
La métaphore de la lumière et de l’obscurité (« je cherche des lumières avec une agitation qui me dévore, et je me trouve sans cesse dans la plus profonde obscurité.
») renvoie à un symbolisme classique du savoir et de l’ignorance, appliqué ici aux sentiments et aux perceptions culturelles de Zilia. L’opposition entre « lumières » et « obscurité » souligne l’inefficacité de la raison face à l’émotion et à l’inquiétude, exprimée avec intensité à travers le verbe « dévore ». Le désarroi de Zilia est patent.
Lettres d’une Péruvienne, lettre 9, Conclusion
En définitive, cet extrait de la lettre 9 met en évidence les premiers pas de Zilia dans la découverte du monde européen. Elle incarne une femme qui oscille entre espoir et inquiétude, croyance et doute, naïveté et lucidité. Françoise de Graffigny fait de ce regard étranger une force pour montrer les difficultés de communication entre deux langues. De plus, elle permet de critiquer l’attitude de Déterville qui, par sa supériorité linguistique et masculine, manipule la jeune fille.
Ce procédé du regard extérieur rappelle d’autres œuvres épistolaires comme Les Lettres persanes de Montesquieu, où Usbek et Rica en voyage en France découvrent avec étonnement les mœurs européennes.
Tu étudies Lettres d’une Péruvienne ? Regarde également :
- Le mouvement des Lumières
- Lettres d’une Péruvienne : dissertation corrigée
- Lettre d’une Péruvienne, lettre 4 : analyse
- Lettres d’une Péruvienne, lettre 10 : analyse
- Lettres d’une Péruvienne, lettre 20 : analyse
- Lettres d’une Péruvienne, lettre 21 : analyse
- Lettres d’une Péruvienne, lettre 29 : analyse
- Lettres d’une Péruvienne, lettre 34 : analyse
- Lettres d’une Péruvienne, lettre 38 : analyse
Les 3 vidéos préférées des élèves :
- La technique INCONTOURNABLE pour faire décoller tes notes en commentaire [vidéo]
- Quel sujet choisir au bac de français ? [vidéo]
- Comment trouver un plan de dissertation ? [vidéo]
Tu entres en Première ?
Commande ton livre 2026 en cliquant ici ⇓

En Troisième ?
Ton livre pour le Brevet ici ⇓

