Tu passes le bac de français ? CLIQUE ICI et deviens membre de commentairecompose.fr ! Tu accèderas gratuitement à tout le contenu du site et à mes meilleures astuces en vidéo.
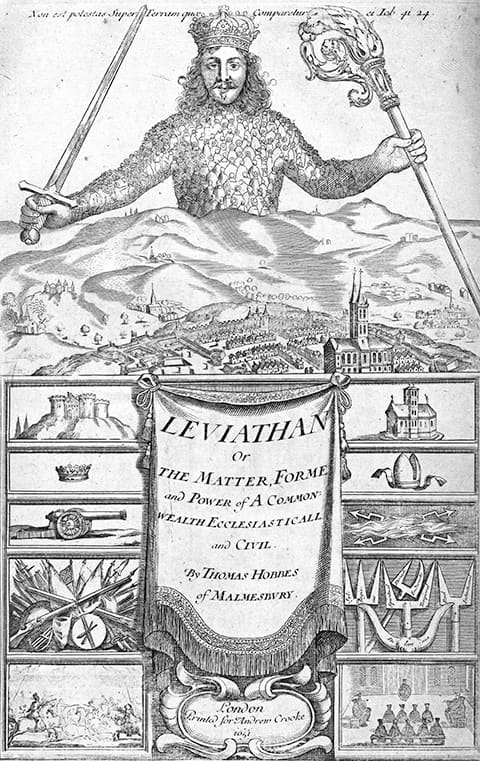
Voici une dissertation sur Discours de la servitude volontaire de La Boétie (parcours au bac de français : « Entretenir » et « défendre » la liberté).
Important : Pour faciliter ta lecture, le plan de cette dissertation est apparent et le développement est présenté sous forme de liste à puces. N’oublie pas que le jour J, ton plan et ton développement doivent être intégralement rédigés. Tu trouveras ici un exemple de dissertation rédigé comme tu dois le faire le jour du bac.
Sujet de dissertation :
« Soyez résolus de ne plus servir, et vous voilà libres. » Selon vous, cette œuvre propose-t-elle une véritable méthode pour défendre la liberté ?
Pour que ce corrigé te soit utile, entraîne-toi auparavant à réaliser ce sujet à l’aide de ma fiche de lectur et ma vidéo sur Discours de la servitude volontaire !
Introduction
[Accroche] Dans le roman dystopique 1984, George Orwell imagine une société où la liberté a été totalement anéantie par un pouvoir tyrannique omniprésent. Le peuple y vit sous la surveillance de Big Brother, sans même avoir conscience de son oppression.
[Présentation de l’oeuvre] Trois siècles plus tôt, Étienne de La Boétie posait déjà cette question centrale dans son Discours de la servitude volontaire. Écrit vers 1546-1548, ce texte précurseur du siècle des Lumières s’attaque avec force à la tyrannie. La Boétie y affirme que le pouvoir du despote repose uniquement sur le consentement de ceux qu’il opprime et il écrit : « Soyez résolus de ne plus servir, et vous voilà libres.
»
[Problématique] Dans quelle mesure Discours de la servitude volontaire propose-t-il une méthode pour défendre la liberté ? En affirmant « Soyez résolus de ne plus servir, et vous voilà libres », La Boétie présente-t-il une voie d’émancipation applicable dans la réalité, ou s’agit-il d’un idéal moral difficilement atteignable ? Cette œuvre peut-elle être lue comme un manuel de résistance ou bien comme un texte fondateur dont la force réside davantage dans l’inspiration que dans l’action ?
[Plan] Le Discours de La Boétie semble, à première vue, proposer une véritable méthode pour défendre la liberté. Mais derrière cette apparente simplicité, le jeune humaniste s’attache surtout à analyser les rouages de la tyrannie et les raisons de sa persistance. Son texte se présente ainsi moins comme un manuel d’action que comme une réflexion morale et littéraire, destinée à éveiller les consciences et à préparer les esprits à la liberté.
I – Une œuvre qui semble proposer une méthode de défense de la liberté
A – Un présupposé : la liberté est un bien naturel et désirable
Pour La Boétie, la liberté est naturelle et relève même de la volonté divine.
Exemple 1: Ainsi, « s’il y a quelque chose de clair et d’évident en la nature, et face à quoi il ne soit pas permis de faire l’aveugle, c’est que la nature, le ministre de Dieu, la gouvernante des hommes, nous a tous faits de même forme, et, comme il me semble, au même moule, pour nous permettre de nous reconnaître tous, mutuellement, comme compagnons, ou plutôt comme frères.
» Or de l’égalité naturelle des hommes découle leur liberté : « il ne peut venir à l’esprit de personne que, nous ayant mis tous en même compagnie, la nature ait placé certains en servitude
»
Exemple 2 : Pour La Boétie, la simple observation des animaux permet de confirmer que la liberté est naturelle. En effet, les animaux se défendent becs et ongles si on leur arrache leur liberté : « des plus grandes aux plus petites, lorsqu’on les prend, font si grande résistance d’ongles, de cornes, de bec et de pieds qu’elles démontrent assez, par là, combien elles tiennent chèrement à ce qu’elles perdent.
«
B – Un constat : le peuple se soumet volontairement au tyran
La Boétie affirme que le tyran n’a aucun pouvoir si le peuple ne lui est pas soumis. Sa thèse se fonde sur un paradoxe : ce n’est pas le tyran qui impose sa domination, mais les individus eux-mêmes qui choisissent inconsciemment de le servir. Il montre que le pouvoir des tyrans ne repose pas nécessairement sur la contrainte physique, mais sur le consentement inconscient des dominés.
Exemple 1 : La Boétie dépeint le tyran comme un être monstrueux qui tire son pouvoir du peuple : « D’où a-t-il pris tant d’yeux dont il vous épie, si ce n’est vous qui les lui donnez ? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper, s’il ne les prend de vous ?
« .
Exemple 2 : Dans la fable politique La ferme des animaux de George Orwell (1945), les animaux d’une ferme se révoltent contre leur maître humain, Mr. Jones, et prennent le pouvoir, guidés par les cochons. Mais très vite, une nouvelle tyrannie se met en place sous l’autorité de Napoléon, le cochon dictateur. Alors même qu’ils aspiraient à la liberté, les animaux acceptent d’obéir aux cochons. Ils sont alors incapables de comprendre qu’ils sont à nouveau exploités, parfois même plus durement qu’avant la révolution.
C – Une solution : cesser de soutenir le tyran
La Boétie n’appelle pas à la violence ou au régicide. Il exhorte simplement le peuple à ne plus servir le tyran, dans une forme de résistance passive, qui semble être un mode d’emploi pour faire tomber la tyrannie.
Exemple : L’image du colosse aux pieds d’argile qui s’écroule en absence de soutien illustre cette résistance passive, non violente, prônée par La Boétie : « Je ne veux pas que vous le poussiez, ni que vous l’ébranliez, mais seulement ne le soutenez plus, et vous le verrez, comme un grand colosse dont on a dérobé la base, s’effondrer de son propre poids et se briser.
«
II – Mais l’entretien et la défense de la liberté se heurtent à de nombreux obstacles
Si Étienne de La Boétie exhorte les peuples à cesser de servir le tyran, il reconnaît dans son Discours les nombreux obstacles qui se lèvent sur le chemin de la liberté.
A – Le poids des habitudes
La Boétie distingue les peuples tombés en servitude, souvent soumis par la violence, des générations suivantes, nées dans la servitude. Ne connaissant pas d’autre état, « n’ayant jamais connu la liberté, ne sachant même pas ce que c’est
« , leur ignorance les pousse à l’inaction.
L’auteur humaniste va plus loin en soulignant qu’une éducation mal orientée peut entretenir cet état : loin de toujours éveiller l’esprit, l’éducation peut être façonnée par le tyran pour détourner les peuples de leur désir naturel de liberté, en les accoutumant dès l’enfance à obéir et à se contenter de distractions.
B – Les mécanismes d’aliénation du peuple
La Boétie décrit également les mécanismes d’aliénation collective, qui empêchent le peuple de réclamer sa liberté.
Exemple 1 : Ainsi, contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, la servitude n’est pas toujours imposée par la seule violence. Le tyran use aussi des jeux et divertissements pour abêtir les hommes et les détourner de la liberté véritable : « Mais ce qu’il y a de sûr et certain, c’est que le tyran ne croit jamais sa puissance assurée, tant qu’il n’est pas parvenu à ce point de n’avoir plus pour sujets que des hommes sans valeur aucune.
» La Boétie prend l’exemple des peuples de l’Antiquité : « Les théâtres, les jeux, les farces, les spectacles, les gladiateurs, les bêtes étranges, les médailles, les tableaux et autres drogues analogues étaient, pour les peuples anciens, les appâts de la servitude, le prix de leur liberté ravie, les outils de la tyrannie.
«
Exemple 2 : Le tyran peut aussi plonger volontairement le peuple dans l’ignorance, en détruisant et interdisant les livres : « Le Grand Turc s’est bien aperçu que les livres et la bonne éducation inspirent aux hommes, plus que tout autre chose, le bon sens et l’intelligence de se reconnaître et de haïr la tyrannie.
«
C – Le secret du maintien de la servitude
Étienne de La Boétie analyse minutieusement « le secret de la domination, le soutien et le fondement de la tyrannie.
«
Selon lui, la tyrannie est maintenue en place grâce à un système pyramidal : le tyran est soutenu par cinq ou six proches qui disposent chacun d’une centaine d’hommes sous leurs ordres, et ainsi de suite, si bien qu’une multitude de « tyranneaux » maintiennent dans la sujétion ceux qui se situent en-dessous d’eux.
La Boétie s’insurge contre ces « tyranneaux » qui préfèrent jouir de privilèges matériels plutôt que de défendre leur liberté. En échange de ces avantages, ils soutiennent le tyran et assurent la soumission de ceux qui leur sont subordonnés. Cette organisation en chaîne, où chacun trouve intérêt à maintenir l’ordre établi, illustre la complexité du pouvoir tyrannique et explique pourquoi son renversement peut s’avérer si difficile.
III -Une méthode surtout morale et intellectuelle
A – Une texte plus exhortatif que prescriptif
Ecrit vers les 18 ans d’Etienne de La Boétie, le Discours sur la servitude volontaire ne propose pas un réel programme politique. Ce texte est plus exhortatif que prescriptif.
Exemple 1 : L’écriture de La Boétie est fougueuse et l’auteur mobilise tout son art oratoire pour exhorter le peuple à se libérer de la tyrannie et lui rappeler sa responsabilité dans sa propre servitude. Il se fait l’avocat de la liberté et utilisant une éloquence proche de celle du prétoire. L’usage de questions oratoires, d’hyperboles, de gradations ascendantes et d’antithèses créent un effet dramatique :
Nommerons-nous cela lâcheté ? Appellerons-nous vils et couards ces hommes soumis ? Si deux, si trois, si quatre cèdent à un seul, c’est étrange, mais toutefois possible ; on pourrait peut-être dire avec raison : c’est faute de coeur. Mais si cent, si mille souffrent l’oppression d’un seul, dira-t- on encore qu’ils n’osent pas s’en prendre à lui, ou qu’ils ne le veulent pas, et que ce n’est pas couardise, mais plutôt mépris ou dédain ?
Exemple 2 : Deux siècles plus tard, dans Le Contrat social (1762), Rousseau, quant à lui, propose un modèle politique précis : la souveraineté du peuple, la volonté générale et des lois légitimes. À l’inverse de la Boétie, Rousseau trace donc une voie institutionnelle vers la liberté.
B -Une réflexion à visée universelle
Deux siècles avant les Lumières et la Révolution française, La Boétie engage une réflexion d’une portée qui dépasse largement son époque. Il ne se contente pas de dénoncer la servitude : il en explore les implications morales et politiques, en posant les bases d’un idéal fondé sur trois piliers qui marqueront durablement la pensée française : l’égalité, la liberté et la fraternité.
Exemple : Pour lui, l’égalité est un fait premier, inscrit dans l’ordre naturel : « la nature a fait les hommes égaux
». Elle ne se discute pas, car elle est manifeste dans toutes les sphères de l’existence. De cette égalité essentielle découle logiquement la fraternité, comprise comme la reconnaissance mutuelle entre semblables, et la liberté, qui en est le corollaire nécessaire. La servitude apparaît alors comme une aberration rationnelle : elle nie ce que la nature a voulu, et introduit une hiérarchie artificielle et injuste entre les hommes.
Ainsi, loin de livrer un simple mode d’emploi pour se libérer du tyran, La Boétie offre un socle intellectuel universel. Sa démarche n’est pas celle d’un stratège politique, mais celle d’un humaniste qui prépare les esprits, convaincu que la liberté véritable ne peut naître que d’une prise de conscience partagée.
C – Un appel à la responsabilité des intellectuels
Après avoir constaté que le peuple asservi a perdu le goût de la liberté, La Boétie rappelle l’existence de « quelques-uns, de meilleure naissance que les autres, qui sentent le poids du joug et ne peuvent se retenir de le secouer
« . Cette élite, « ayant l’entendement net et l’esprit clairvoyant
» ne peut goûter à la servitude et continuera de défendre la liberté. Il en appelle donc à une élite capable de guider le peuple et de raviver en lui le goût pour la liberté.
C’est finalement ce que fait La Boétie lui-même avec son Discours. Le philosophe veut éveiller les consciences : si les individus comprenaient ce qui se joue dans l’exercice du pouvoir, ils cesseraient naturellement de se soumettre.
Conclusion
Discours de la servitude volontaire a fait l’objet de nombreuses récupérations politiques, par ceux qui voyaient dans ce texte une méthode de défense de la liberté radicale qui consiste à désobéir et à refuser l’oppression.
Toutefois, l’approche de La Boétie reste surtout morale et intellectuelle : il ne s’agit donc pas de donner au lecteur un plan d’action politique mais de réveiller sa conscience d’honnête homme.
Ouverture : La position de La Boétie sur la servitude des peuples trouve un écho dans Lettres persanes de Montesquieu. À travers le regard étranger de Rica et Usbek sur la société française, l’auteur dénonce l’aveuglement des hommes face à la tyrannie politique par exemple. Grâce à la littérature, le lecteur est invité à prendre du recul, à interroger ce qui paraît normal, et à refuser l’obéissance par habitude, seules conditions pour être libre.
Analyses linéaires sur des extraits de Discours de la servitude volontaire :
- Discours de la servitude volontaire, début (exposé du sujet)
- Discours de la servitude volontaire, la description de la servitude du peuple (« peuples misérables… »)
- Discours de la servitude volontaire, comment la servitude s’installe par habitude
- Discours de la servitude volontaire, la liberté est naturelle
- Discours de la servitude volontaire, les ruses pour abêtir le peuple
- Discours de la servitude volontaire, le secret du maintien du tyran au pouvoir
Autres dissertations rédigées :
- Dissertation sur La Peau de chagrin
- Dissertation sur Sido et Les Vrilles de la vigne
- Dissertation sur Manon Lescaut
- Dissertation sur On ne badine pas avec l’amour
- Dissertation sur Pour un oui ou pour un non
- Dissertation sur Le Menteur
- Dissertation sur Cahiers de Douai
- Dissertation sur Mes forêts d’Hélène Dorion
- Dissertation sur La Rage de l’expression
- Dissertation sur Entretiens sur la pluralité des mondes
- Dissertation sur Lettres d’une Péruvienne
Dissertations sur l’ancien programme :
Les 3 vidéos préférées des élèves :
- La technique INCONTOURNABLE pour faire décoller tes notes en commentaire [vidéo]
- Quel sujet choisir au bac de français ? [vidéo]
- Comment trouver un plan de dissertation ? [vidéo]
Tu entres en Première ?
Commande ton livre 2026 en cliquant ici ⇓

En Troisième ?
Ton livre pour le Brevet ici ⇓

