Tu passes le bac de français ? CLIQUE ICI et deviens membre de commentairecompose.fr ! Tu accèderas gratuitement à tout le contenu du site et à mes meilleures astuces en vidéo.
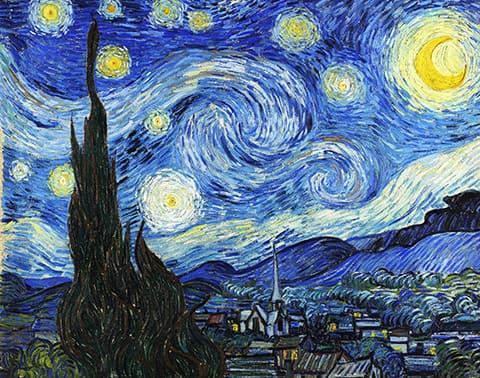
Voici une dissertation sur Entretiens sur la pluralité des mondes de Fontenelle (parcours au bac de français : Le goût de la science).
Important : Pour faciliter ta lecture, le plan de cette dissertation est apparent et le développement est présenté sous forme de liste à puces. N’oublie pas que le jour J, ton plan et ton développement doivent être intégralement rédigés. Tu trouveras ici un exemple de dissertation rédigé comme tu dois le faire le jour du bac.
Sujet de dissertation :
Selon vous, le plaisir que prend le lecteur à lire Entretiens sur la pluralité des mondes repose-t-il uniquement sur les savoirs scientifiques qu’il y découvre ?
Pour que ce corrigé te soit utile, entraîne-toi d’abord à réaliser toi-même un plan sur ce sujet. Aide-toi de ma fiche et vidéo sur Entretiens sur la pluralité des mondes.
Introduction
Amorce : Déjà au Ier siècle avant Jésus-Christ, le poète latin Lucrèce transmettait au lecteur, dans un poème en hexamètres, la vision du monde d’Epicure dans son poème De rerum natura. Véritable poète-philosophe, il révèle des principes physiques tels que le mouvement de la nature, ou la présence du vide et d’atomes qu’il appelle corps invisibles.
De la même façon, en 1686, dans Entretiens sur la pluralité des mondes, Bernard de Fontenelle prend le même plaisir à faire découvrir à son lecteur les savoirs scientifiques de son époque, comme le système copernicien sous la forme d’un dialogue entre un philosophe et une marquise.
Problématique : Dans quelle mesure le plaisir procuré par la lecture des Entretiens sur la pluralité des mondes dépend-il de la transmission de connaissances scientifiques ? Le plaisir du lecteur ne dépend-il pas aussi d’autres facteurs ? Comment l’art de la vulgarisation, le ton mondain et le charme littéraire participent-ils eux aussi à captiver le lecteur ?
Annonce de plan : Dans un premier temps, nous mettrons en évidence que le plaisir du lecteur vient des savoirs scientifiques transmis. Mais le genre littéraire et le ton employés sont également sources de divertissement. Enfin, nous montrerons que les Entretiens stimulent surtout le plaisir de la réflexion philosophique.
I – La vulgarisation de savoirs scientifiques comme socle du plaisir de la lecture
A – La joie d’accéder à des savoirs scientifiques nouveaux
Fontenelle rend accessibles des concepts auparavant réservés aux savants. Au XVIIème sècle, l’héliocentrisme, les éclipses ou la théorie des tourbillons de Descartes ne sont pas des concepts évidents pour tous. Fontenelle offre au lecteur profane la possibilité de pénétrer un univers réservé jusque-là aux initiés.
Exemple 1 : Dès le Premier Entretien, Fontenelle suscite la curiosité du lecteur. Il explique que la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil et que l’héliocentrisme est plus vraisemblable que le géocentrisme, position déjà soutenue par Galilée en 1633.
Exemple 2 : Devenu membre de l’Académie française en 1691, et en tant que secrétaire perpétuel de l’Académie Royale des sciences, chaque année, Fontenelle s’attache à rédiger la partie « Histoire » dans Histoire et Mémoires de l’Académie Royale des Sciences. L’enjeu est de vulgariser les découvertes scientifiques complexes de l’année écoulée, pour le grand public. Les sujets variés pouvaient concerner la botanique comme la physique.
B – Le plaisir intellectuel de comprendre
La simple découverte ne suffit pas : le plaisir naît surtout lorsque le lecteur suit le raisonnement et comprend les principes scientifiques. Le lecteur est ainsi placé dans une quête, ou face à une démonstration logique. Comprendre un raisonnement nouveau devient donc enthousiasmant : c’est un puissant ressort du plaisir de la lecture.
Exemple 1 : Le philosophe-narrateur a recours à une démarche hypothético-déductive, comme un scientifique, afin d’entraîner la Marquise et le lecteur au raisonnement scientifique. Par exemple, il suppose d’abord la présence d’habitants sur les planètes, puis consacre les Deuxième et Troisième Soir à examiner la validité de cette idée.
Exemple 2 : Dans La lettre sur les aveugles à l’usage de ceux qui voient (1749), Diderot met en scène un aveugle de naissance, mathématicien et géomètre anglais, Nicholas Saunderson. Ce dernier est capable de concevoir des raisonnements mathématiques très abstraits sans jamais avoir vu la lumière ni les formes géométriques. Le lecteur prend plaisir à suivre un raisonnement contre-intuitif, qui bouleverse les idées reçues : Diderot prouve que la pensée scientifique ne dépend pas de la vue mais de la pure logique.
C – L’enthousiasme pour le progrès scientifique
Une fois que le lecteur comprend les découvertes scientifiques, son plaisir se renforce en voyant comment elles s’inscrivent dans une vision globale de l’univers. Il peut contempler l’ordre et la diversité du cosmos et se rendre compte que les connaissances scientifiques permettent de mieux comprendre le monde qui l’entoure.
Exemple : Au Cinquième soir, le philosophe montre à la Marquise que chaque étoile fixe est un Soleil entouré de ses propres planètes. Cette révélation sur l’immensité et la variété infinie des mondes suscite chez le lecteur un enthousiasme intellectuel et moral, car elle révèle un univers riche et plein de surprises.
II – Le plaisir de la lecture tient aussi à la forme littéraire et aux registres choisis
A – Des choix littéraires originaux
Fontenelle utilise le dialogue philosophique pour rendre la science accessible et vivante. La Marquise curieuse incarne le lecteur profane et permet une conversation fluide, presque théâtrale, loin de l’environnement austère d’un laboratoire. Les dialogues insufflent dynamisme et vivacité à une matière difficile d’accès. De plus, le cadre mondain et nocturne crée une atmosphère séduisante et poétique.
Exemple 1 : Lors du Premier soir, le philosophe et la Marquise se promènent dans le parc du château au crépuscule. Le dialogue rend l’échange vivant et plaisant : la science n’est pas présentée comme un exposé académique, mais comme une conversation galante et imagée. L’ouvrage est donc loin de commencer comme un traité scientifique, comme le souligne l’une de ces premières répliques du philosophe : « Ne trouvez-vous pas, lui dis-je, que le jour même n’est pas si beau qu’une belle nuit ?
«
Exemple 2 : Un siècle plus tard, Voltaire fait le choix du conte philosophique pour introduire des idées scientifiques et philosophiques. Dans Micromégas, il imagine un géant venu d’une autre planète, afin de tourner en dérision l’orgueil humain et souligner la relativité des points de vue. Ces choix littéraires originaux participent au plaisir du lecteur.
B – Un ton léger et séduisant
Dès la préface, Fontenelle annonce son double objectif : plaire et instruire. Il écrit : « J’ai voulu traiter de philosophie d’une manière qui ne fût point philosophique […] ni trop sèche pour les gens du monde, ni trop badine pour les savants
. » Le ton utilisé est donc léger, voire badin.
Exemple : Fontenelle ne dissocie pas la quête de la connaissance et celle de l’amour. Dès le Premier Soir, le philosophe assimile plaisir intellectuel et plaisir amoureux en déclarant : « Une blonde comme vous me ferait encore mieux rêver que la plus belle nuit du monde avec toute sa beauté brune.
«
Les Entretiens sont particulièrement savoureux pour le lecteur de l’époque car on y retrouve l’esprit des salons mondains, où fuse l’art de la répartie. Le lecteur prend plaisir à suivre les échanges vifs, raffinés et intellectuels des protagonistes.
Exemple : Dans le sixième soir, la Marquise accuse le narrateur sur le ton du badinage de lui avoir « gâté l’esprit ». L’expression « gâter l’esprit » mêle le champ de l’éducation (gâter au sens de corrompre, fausser) à celui de la galanterie (gâter au sens de détourner, séduire). Le narrateur répond sur le même ton : « Je serais bien glorieux […] d’avoir eu tant de pouvoir sur vous » et ajoute « je ne crois pas qu’on pût rien entreprendre de plus difficile
». Cette réplique feint l’humilité tout en flattant la Marquise. On est davantage dans le jeu mondain et le registre de la séduction que dans le dialogue scientifique.
L’humour et l’ironie permettent également de moquer les croyances anciennes et les superstitions.
Exemple : Dans le Troisième entretien, en parlant de la possibilité d’une vie sur la Lune, Fontenelle écrit : « Il y a des gens dans la Lune qui ont la tête en bas et les pieds en haut, par rapport à nous.
» Il joue sur l’imaginaire et les représentations absurdes de l’époque, tout en montrant que ces idées sont en réalité le fruit de notre point de vue terrestre. Toujours dans cet Entretien, il se plaît à manier l’humour lorsqu’il imagine des habitants sages et méditatifs sur Jupiter ou passionnés et inconstants sur Vénus. Il mêle ici science, psychologie et fantaisie pour mieux capter l’auditoire.
C – La puissance des images utilisées
Au-delà du cadre galant et du ton léger, le plaisir de lecture des Entretiens tient également à la puissance des images que Fontenelle emploie. Les métaphores concrètes et poétiques rendent accessibles des concepts scientifiques complexes et permettent au lecteur de visualiser l’univers de façon vivante et plaisante.
Exemple 1 : Dans le Premier Soir, pour expliquer la conception mécaniste du monde inspirée de Descartes, le philosophe compare l’univers aux rouages d’un théâtre : « la nature est un grand spectacle, qui ressemble à celui de l’Opéra […] on cache à votre vue ces roues et contre-poids qui font tous les mouvements
». Cette image concrète permet à la Marquise, et par là au lecteur, de comprendre que, derrière l’apparence harmonieuse du ciel, se cachent des mécanismes régis par des lois physiques.
Exemple 2 : Dans le Cinquième Soir, le philosophe développe une image ludique pour faire comprendre la théorie des tourbillons de Descartes : ces derniers « s’ajustent comme les engrenages d’une montre, en gonflant et en se dégonflant comme des ballons de toutes les tailles
». La Marquise réagit avec enthousiasme à cette image, comme pourrait le faire le lecteur : « J’aime ces ballons qui s’enflent et se dégonflent à chaque moment, et ces mondes qui se combattent toujours
». Le philosophe complète cette représentation par de nouvelles images poétiques qui permettent de lier compréhension de l’univers, plaisir et émerveillement : « Les mondes voisins nous envoient quelquefois […] des comètes, qui sont ornées, ou d’une chevelure éclatante, ou d’une barbe vénérable, ou d’une queue majestueuse
».
III – Le plaisir philosophique : réfléchir à la place de l’homme
A – La relativisation de la place de l’homme
Au-delà du plaisir immédiat de la lecture ou de la compréhension de concepts scientifiques précis, Fontenelle invite à changer de perspective pour adopter un regard relativiste sur la place de l’homme dans l’univers. En découvrant que la Terre n’est qu’un astre parmi d’autres, le lecteur est amené à réfléchir à la relativité de la condition humaine.
Exemple : Dans le Sixième entretien, Fontenelle conclut que l’homme n’est pas le centre de l’univers : « Nous ne sommes rien, et il n’y a peut-être pas de si grande gloire à avoir été fait homme.
» Ce passage illustre la portée philosophique de l’œuvre : en découvrant l’immensité du cosmos, le lecteur est amené à relativiser la place de l’homme.
B – Le plaisir de développer une réflexion critique
Fontenelle invite le lecteur à réfléchir par lui‑même et à remettre en question les idées reçues, en transposant au domaine scientifique la querelle des Anciens et des Modernes qui agite les milieux littéraires au XVIIᵉ siècle.
Cette querelle oppose les Anciens, qui considèrent l’Antiquité comme un modèle indépassable, aux Modernes, ouverts à l’idée de progrès. Fontenelle se range résolument du côté des Modernes et n’hésite pas à tourner en dérision les superstitions et le goût du merveilleux attribués aux Anciens, pour mettre en valeur une approche rationnelle et critique du monde.
Exemple 1 : Dans le Deuxième soir, le philosophe donne des explications rationnelles au phénomène des éclipses. Il écorche au passage les superstitions et rappelle que lors de la précédente éclipse, 32 ans plus tôt, « Une infinité de gens ne se tinrent-ils pas enfermés dans des caves.
» Pourtant, les éclipses s’expliquent rationnellement, et la Marquise s’étonne de la limpidité des explications, qui enlève tout mystère à ce phénomène : « Je suis fort étonnée qu’il y ait si peu de mystère aux éclipses, et que tout le monde n’en devine pas la cause.
»
Exemple 2 : Dans Histoire des oracles publié en 1687, Fontenelle combat également les idées reçues et les croyances irrationnelles liées à la tradition. Avec le célèbre apologue de « La dent d’or », il rappelle que les « miracles » cachent des explications simples et rationnelles. Cette remise en cause des préjugés participe avant l’heure à l’esprit des Lumières et au plaisir du développement de l’esprit critique.
C – Le plaisir de réfléchir sur le rôle de la vérité et du jugement
Le plaisir que procure la lecture des Entretiens tient aussi à l’absence de dogmatisme de Fontenelle. L’auteur se montre ouvert à des hypothèses multiples et adopte un ton léger, « riant », face aux différentes opinions. Le lecteur est invité à explorer les possibles, sans subir une autorité scientifique imposée. Fontenelle fait aussi preuve de relativisme et de pragmatisme social : il faut, selon lui, s’arranger avec la vérité pour ne pas surprendre, heurter ou froisser son interlocuteur.
Exemple : Dans le Sixième soir, le narrateur conseille à la Marquise : « Contentons-nous d’être une petite troupe choisie qui les croyons, et ne divulguons pas nos mystères dans le peuple
». Il signale à la Marquise qu’il faut adapter la vérité à l’auditoire pour préserver les relations sociales. La jeune femme s’indigne : « Trahir la vérité ! Vous n’avez point de conscience
», mais le philosophe répond avec détachement : « je n’ai pas un grand zèle pour ces vérités-là, et que je les sacrifie volontiers aux moindres commodités de la société
».
Conclusion
Au terme de cette analyse, il est indéniable que le plaisir de la lecture des Entretiens sur la pluralité des mondes naît de la découverte de savoirs scientifiques nouveaux et passionnants, comme l’héliocentrisme.
Mais il naît également d’un genre littéraire original – le dialogue philosophique – et du recours à un ton léger voire badin.
Enfin, le plaisir de la lecture vient surtout de la rencontre entre la science, la philosophie et la pensée critique. Fontenelle invite le lecteur à réfléchir à la place de l’homme dans l’univers, à adopter un esprit critique, curieux et ouvert, tout en explorant les limites du savoir et de la vérité.
Source de plaisir scientifique, littéraire et philosophique, la littérature n’a donc pas fini de subjuguer et d’interroger le lecteur. Voyage au centre de la Terre de Jules Verne est un roman qui lie également rigueur scientifique et plaisir de l’aventure et de l’imagination : le lecteur s’émerveille des découvertes géologiques et biologiques tout en étant transporté dans un univers fantastique, soulignant le rôle que la littérature peut jouer pour attiser le goût de la science.
Analyses linéaires sur des extraits d’Entretiens sur la pluralité des mondes :
- Entretiens sur la pluralité des mondes, adresse à Monsieur L…
- Entretiens sur la pluralité des mondes, Premier soir
- Entretiens sur la pluralité des mondes, sixième soir
Dissertations sur les autres oeuvres au programme :
- Dissertation sur On ne badine pas avec l’amour
- Dissertation sur Pour un oui ou pour un non
- Dissertation sur Le Menteur
- Dissertation sur La Peau de chagrin
- Dissertation sur Sido et Les Vrilles de la vigne
- Dissertation sur Manon Lescaut
- Dissertation sur La Rage de l’expression
- Dissertation sur Mes forêts
- Dissertation sur Cahiers de Douai
- Dissertation sur Discours de la servitude volontaire
- Dissertation sur Lettres d’une Péruvienne
Dissertations sur l’ancien programme :
- Dissertation sur Juste la fin du monde
- Dissertation sur Le Malade imaginaire
- Dissertation sur Les Fausses confidences
- Dissertation sur Gargantua
- Dissertation sur Les Caractères
- Dissertation sur La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne
Les 3 vidéos préférées des élèves :
- La technique INCONTOURNABLE pour faire décoller tes notes en commentaire [vidéo]
- Quel sujet choisir au bac de français ? [vidéo]
- Comment trouver un plan de dissertation ? [vidéo]
Tu entres en Première ?
Commande ton livre 2026 en cliquant ici ⇓

En Troisième ?
Ton livre pour le Brevet ici ⇓


Bonjour,
J’ai remarqué que vous utilisiez plusieurs fois le terme de « lecteur profane » (1er para du I/A et 1er para du II/A). Quand je cherche la definition de l’adjectif je trouve : « Qui est étranger à la religion (opposé à religieux, sacré). » ou « Personne qui n’est pas initiée à une religion. » Or je ne vois pas le lien avec la religion ici? Pourriez vous m’éclairer ?
Bonjour Ella,
Profane signifie aussi « qui n’est pas initié à quelque chose (une science, un art…). Ici, le lecteur profane est le lecteur qui n’est pas initié aux sciences.